DÉCROCHEURS
L'histoire des Décrocheurs est celle d'une sociabilité choisie
contre une sociabilité imposée.
Elle rappelle qu'il existe des variantes à un modèle qui n'en tolère aucune.
05 - tohu bohu
temps de lecture : 87 minutes, 73 illustrations

Jean Ignace Isidore Grandville (1803-1847)
La Bataille d'Hernani (détail)
gravure, 1830
La Brasserie des Martyrs
théâtre de la bohème
Le Carnaval de Paris : l’oublié flamboyant
S’il est un événement populaire, majeur en son temps, que l’histoire officielle a méthodiquement relégué dans ses marges, c’est bien le Carnaval de Paris. Pendant plusieurs siècles, cette fête spectaculaire, licencieuse et terriblement subversive fut un rendez-vous incontournable du calendrier parisien. Elle succède, dès le XVe siècle, à la Fête des Fous médiévale, dans un esprit similaire de renversement des hiérarchies et de suspension des normes : un temps d’inversion totale, où l’ordre est mis cul par-dessus tête, où les puissants sont moqués, les hommes travestis, et les femmes, provisoirement, affranchies.

Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns, dit Bertall (1820-1882)
Couple de Parisiens en Carnaval 1847
C’est là une fête insensée, orgiaque, débridée, mais codifiée. Une fête de tous les excès, mais traversée par des traditions bien vivantes. Dès l’époque moderne, les corporations s’en emparent : les bouchers, notamment, organisent d’imposants cortèges à l’occasion des « dimanches gras », tandis que les Goguettes – ces sociétés chantantes populaires – investissent l’espace public de leurs satires et de leurs refrains polémiques. Le Carnaval devient, pour quelques jours, un théâtre urbain où chacun peut prendre la parole masquée, et où tout est permis, ou presque.

Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns, dit Bertall (1820-1882)
Le Carnaval des Boulevards en 1828
Le Journal pour Tous, 2 février 1856
Du XVIIe au XIXe siècle, le Carnaval de Paris développe un folklore bien établi. Des personnages typiques, reconnaissables à leurs costumes, reviennent chaque année. On y pratique les fameuses « attrapes en Carnaval », des farces rituelles héritées des traditions de l’Ancien Régime. Pendant les jours gras – dimanche, lundi, mardi – et surtout lors du jeudi de la Mi-Carême, les cortèges envahissent les grands boulevards, au point qu’il faut interrompre la circulation. Les foules, denses et délirantes, reflètent un Paris populaire pour qui ces fêtes sont un exutoire collectif.

Clément Pruche (1811-1890)
Quelle prodigieuse bête !!! Si nous pouvions être un jour de cette force là !
Caricature du Bœuf Gras du Carnaval de Paris, 1843
Bien sûr, tout le monde n’apprécie pas. Une partie du clergé, surtout le plus réactionnaire, s’en indigne. Cette parenthèse dionysiaque dans le calendrier chrétien choque les tenants de l’ordre moral, notamment parce qu’elle autorise les femmes – pour une fois – à s’exprimer librement, à se vêtir autrement, à sortir, à rire. L’Église y voit une dérive, la bourgeoisie une menace.

H onoré Daumier (1808-1879)
Tu t ‘amuses trop !
Le Monde Illustré, 22 février 1868
Le XIXe siècle, en tout cas, en raffole. Il en fait un sujet de prédilection. Caricaturistes et peintres s’en emparent. Gavarni, Cham, Gustave Doré, Honoré Daumier documentent cette liesse, en soulignent la force grotesque, la critique sociale latente. Manet lui-même en montre une scène dans l’un de ses tableaux, peignant une soirée de bal masqué à l’Opéra.

P aul Gavarni (1804-1886)
Couple de Carnavaleux Parisiens, 1852
Mais le Carnaval de Paris n’a pas survécu au XXe siècle. Déjà fragilisé par la transformation de la ville haussmannienne, il s’essouffle lentement avant de s’éteindre tout à fait avec la Seconde Guerre mondiale. Aucun décret, aucune interdiction : simplement, le monde a changé. Les formes de la fête aussi. Ce qui faisait rire ou trembler ne fait plus ni l’un ni l’autre. Il ne reste aujourd’hui que des traces, des images, quelques souvenirs enfouis. Et un grand vide carnavalesque dans la mémoire collective parisienne.

Anonyme
Bataille de confettis sur les Grands Boulevards
Le Monde Illustré du 10 février 1894
la Brasserie des Brasseries
Dans les années 1850-1860, un lieu cristallise l’effervescence bohème : la Brasserie des Martyrs, située au n° 7 de la rue éponyme, au pied de Montmartre. Elle attire autant pour ses prix modiques (la bière y est moins chère que le vin) que pour sa proximité avec les théâtres des grands boulevards, les petites maisons de plaisir, les cabarets, et la vie nocturne.
C’est là que se presse la bohème artistique et littéraire : Gustave Courbet, Henri Murger, Champfleury, Théodore de Banville, Alphonse Daudet, mais aussi une foule d’inconnus, venus chercher là un peu de lumière.
Edmond de Goncourt la nomme la brasserie caverne de tous les bohèmes et du petit journalisme. Alfred Delvau parle lui d’une grande hôtellerie de l’intelligence. Alphonse Daudet, plus cynique, la voit comme une puissance en littérature, où l’on devient célèbre par la brasserie.
Le lieu acquiert une telle renommée qu’il devient presque synonyme de bohème elle-même. Qui veut vivre en bohème va aux Martyrs. Qui veut écrire sur elle, la prend pour décor. Firmin Maillard, dans Les Derniers Bohèmes, l’immortalise comme le temple d’une sociabilité tapageuse, clanique, inventive. Et comme l’espace de la brasserie est des plus vastes, il y accueille tous les écrivains, poètes, littérateurs, journalistes et chroniqueurs de leur temps, qui laisseront pour la postérité de la brasserie quantité de témoignages.
L’histoire de la brasserie des Martyrs fut écrite par ses acteurs-même, produisant un récit dans lequel le mythe est indémêlable des faits.
Et derrière le mythe, se cache une réalité beaucoup plus ambiguë.
Théâtre d’Opération

Louis Montégut (1855-1906)
La Brasserie des Martyrs
BNF, Estampes et Photographies, Inv. Va-286, t.6
La Brasserie est comparée à une arche de Noé artistique, un capharnaüm où se croisent sculpteurs, poètes, journalistes, chansonniers, lithographes, actrices, grisettes et danseuses. L’endroit pue le tabac, la choucroute, le patchouli et l’absinthe. La fumée rend l’air irrespirable et le bruit infernal rend conversations impossibles.
On boit au rabais, notent Octave Féré et Jules Cauvain, mais surtout : on observe, on imite, on raille.
À chaque coin, l’on vous éreinte, à chaque angle, on vous démolit.
Ils n’avaient pas d’autre doctrine que la blague.
La Brasserie est un lieu de passage obligé pour les jeunes écrivains en mal de reconnaissance, venus chercher un peu de ce que Maxime Rude appelle « famosité ». Mais ce qu’ils y trouvent, souvent, c’est la raillerie, l’humiliation ou l’oubli.
Des clans s’affrontent, les écoles s’opposent : les réalistes (Champfleury, Gustave Courbet), les journalistes blagueurs, les poètes vaporeux.
Toutes les écoles parisiennes […] sont là chaque soir, enfermées dans la même cage, écrit Delvau.
Le lieu devient une arène. Duchesne évoque des combats homériques6. La satire remplace le débat, la blague prend le pas sur la pensée. Le sarcasme devient mode de survie.
Théâtre de la cruauté
La Brasserie est aussi le lieu de toutes les impostures. Daudet ironise :
Pour quelques hommes de talent, combien de Desroches ?
Philibert Audebrand parle de ces grands hommes qui aspiraient surtout à se manger le nez. Les statues qu’on y érige sont des « statues de contrebande ». Ce n’est plus un cénacle : c’est un carnaval. Le personnage de Morvieux, chez Catulle Mendès, incarne cette bohème acide, qui cache sa médiocrité derrière le sarcasme, et piétine sans vergogne la belle innocence des prétendants :
Son pire tourment, c’est d’avoir espéré.
À bien des égards, la Brasserie est une antichambre de l’échec. À ceux que l’art ne veut pas reconnaître, elle offre un refuge provisoire et souvent l’illusion d’une consécration. On s’y égare dans le rêve de devenir célèbre, et l’on finit à la « fosse commune ».
De Petrus Borel aux Zutistes : le dernier mot au rire
Si l’esprit frondeur de la bohème fut d’abord une manière de résister à l’ordre bourgeois, il tourna vite à l’autodérision cruelle, voire à l’autodestruction. Cette tendance se cristallise chez Petrus Borel, le « lycanthrope » exalté, qui pousse le romantisme jusqu’à la ruine, et fait de la déchéance un style.
Chez lui, la noirceur devient absolue, prophétique. Mais après Borel, un autre mode de résistance se dessine : le rire. Un rire mordant, ravageur, qui devient une arme contre toutes les formes d’autorité (même celle de l’art).
Les Zutistes, les Hydropathes, les Incohérents : autant de groupes qui, dans le sillage de la bohème, choisissent la parodie, le pastiche, la dérision comme réponse à l’imposture.
Ce n’est plus la grandeur du malheur qu’on célèbre, mais sa caricature. Le rire, comme le dit Audebrand, remplace la doctrine.
L’esprit leur tient lieu de pensée, l’ironie d’œuvre.
Ainsi, de la rage désespérée de Petrus Borel à la blague assassine des Zutistes, un fil rouge traverse toute la bohème parisienne : celui d’une lucidité cruelle, d’une ironie dévorante, d’un refus tenace du sérieux. L’opposition déclarée à la bourgeoisie va passer par l’invective avant de devenir une tentative de destruction de son langage par le rire, dont l’écho va traverser la fin du XIXe jusqu’à rebondir à Munich sur la table du café que fréquentaient Hugo Ball et Vassilly Kandinsky.
La bohème a sans doute échoué à réinventer le monde, mais elle a su en rire. Et cela, c’est peut-être sa victoire la plus éclatante : ce rire survivra à la Semaine Sanglante.
Coups de Griffes
Mais il ne suffisait pas de refaire le monde entre deux verres, accoudé à une table bancale de la Brasserie des Martyrs. Pour exister autrement que dans le bruissement des conversations ou le vacarme des dettes impayées, la bohème parisienne devait aussi s’inventer une scène propre, un théâtre à sa mesure, où ses refus, ses rires et ses éclats prendraient corps. Or, la Brasserie n’était pas seulement un refuge pour les affamés de gloire : elle tenait lieu d’arène, de terrain de jeu pour un humour cruel, souvent ravageur, qui n’épargnait ni les puissants ni les prétentieux. C’est de ce climat d’ironie féroce, attisé par la promiscuité du Quartier Latin et le tumulte des cafés, que la caricature a connu une nouvelle vie.
Tandis que les paysagistes, les réalistes et les révoltés du pinceau bousculaient les canons et les académies, les caricaturistes trouvaient dans leurs audaces un prétexte idéal pour affûter leurs plumes. Rien de plus jubilatoire, en effet, que de railler ceux qui prétendaient renverser l’ordre établi : leurs tableaux devenaient des cibles toutes trouvées pour les sarcasmes du dessin satirique.

Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns, dit Bertall (1820-1882)
La Terrible Savoyarde, par Courbet. Cette terrible Savoyarde propose 500 francs et un caleçon d’honneur à celui qui pourra la tomber : on offre de parier qu’elle tombera M. Courbet dit le Rempart d’Ornans, le même dont les épaules n’ont pas encore touché la terre. Nos éloges sont dus à cette suave composition. La femme courbée, amie de la terrible Savoyarde, est aussi un chef-d’œuvre, et nous paraît résumer les tendances poétiques de l’auteur.
Le Journal pour rire, 25 juin 1853 Nota Bene : le numéro en haut à droite de l’illustration permettait au visiteur de retrouver facilement l’œuvre en question dans l’exposition officielle.
Et pourtant, ces attaques n’engendraient guère de ressentiment durable. Nombre d’artistes visés, comme Gustave Doré, Alexandre-Gabriel Decamps ou, plus surprenant, le jeune Claude Monet, avaient eux-mêmes pratiqué la caricature1 et n’ignoraient rien des plaisirs particuliers qu’elle procure. Comme si, derrière les apparentes oppositions entre art sérieux et irrévérence graphique, on trouvait une communauté souterraine de regards désillusionnés, capables de rire d’eux-mêmes comme du monde.
1Noter à ce sujet que la peinture compte parmi ses genres celui de la Singerie, dont l’origine se situe au XVIIIe siècle comme sous-genre du style rococo, et qui désigne des œuvres montrant des singes adoptant des attitudes humaines tournées en satires et moquant en général les modes les plus récentes.

Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860)
Les Experts
peinture à l’huile sur toile, 46 x 64 cm, 1837
Metropolitan Museum of Art, Inv. 29.100.196
Salons Caricaturaux
C’est dans ce contexte qu’émergèrent les Salons Caricaturaux. Nés d’abord comme simples pastiches ou comptes rendus moqueurs des Salons officiels, ils finirent par s’imposer, dans les années 1840, comme des événements à part entière. Spécialité typiquement parisienne, ces expositions parodiques s’installaient dans le sillage des grandes manifestations artistiques — comme un écho ricanant — et en offraient une version déformée, décapante, souvent bien plus réjouissante que l’original. Leurs succès s’expliquaient par la démesure même des Salons académiques : des centaines, parfois des milliers d’œuvres entassées, un public composite de curieux, de mondains, de critiques et d’intrigants. Un capharnaüm parfait pour inspirer ceux qui, peut-être, sortaient tout juste de la Brasserie des Martyrs, encore ivres de mots et de bière bon marché.

Amédée Charles Henri, Vicomte de Noé, dit Cham (1818-1879)
Malheur ! Avoir placé mon effet de lune en plein soleil !
Caricature parue dans Le Monde Illustré – Le Mois comique par Cham, 6 juin 1868
Presse sécialisée
Sous le Second Empire, ces Salons parodiques atteignirent leur apogée, notamment grâce à la diffusion des comptes rendus illustrés publiés dans des journaux comme Le Charivari ou Le Journal Amusant. Ces chroniques visuelles, véritables instantanés satiriques de la vie artistique parisienne, furent nourries par les dessins des plus grands caricaturistes de l’époque : Gavarni, Cham, Bertall, Nadar, André Gill, Albert Robida, pour n’en citer que quelques-uns. Le principe était simple et redoutablement efficace : une série de vignettes gravées, accompagnées de légendes cinglantes ou de commentaires plus développés, croquant sur le vif les absurdités du Salon.

Carlo Gripp (1826-1900)
Dernière Incarnation de Nadar (Nadar en Ballon fait des croquis du Salon)
La Lune, 20 mai 1866
Dessin à charge
Le dessin relevait de la charge au sens strict : une exagération graphique tournée vers la moquerie. Les œuvres exposées y étaient les cibles privilégiées, qu’elles soient pompièrement académiques ou audacieusement novatrices. On reconnaissait chaque tableau à son numéro, fidèlement reporté dans le dessin depuis le livret officiel, comme pour mieux ancrer la satire dans le réel. Mais rien n’échappait au trait impitoyable des dessinateurs : ni les artistes eux-mêmes, ni les visiteurs, leurs tenues, leurs mines outrées ou ébaubies, ni l’agencement des salles, ni le brouhaha général. Le Salon tout entier devenait un théâtre grotesque où chacun jouait son rôle sans le savoir.
À la croisée de l’esprit bohème et de la critique populaire, ces comptes rendus formaient un étrange pacte de connivence avec le lecteur. Ils raillaient à parts égales les académiciens engoncés dans leur suffisance et les jeunes avant-gardistes trop sûrs d’eux. Leur méthode, calquée sur celle des critiques d’art, substituait aux formules ampoulées des revues officielles un humour féroce, fait de légendes absurdes, de dialogues décalés et de distorsions jubilatoires. Le trait volontairement outré, les métaphores volontairement grossières, la mauvaise foi pleinement assumée : tout concourait à faire de chaque tableau une scène burlesque, et de chaque ambition esthétique, un prétexte à démolition en règle.

Charles Constant Albert Nicolas d’Arnoux de Limoges Saint-Saëns, dit Bertall (1820-1882)
Couleur du Salon de 1852, ou le Salon dépeint et dessiné par Bertall, détail : Vue prise aux environs de Saint-Etienne, par M. Barbier. Paysage commandé par une fabrique de rubans de l’endroit.
Le Journal pour rire, Exemplaire aquarellé, 15 mai 1852
Tous azimuts
Car la caricature n’épargnait personne. Arme à double tranchant, elle sapait l’autorité en ridiculisant les poseurs solennels et le paternalisme bourgeois, mais elle n’hésitait pas non plus à railler les idées nouvelles avant même qu’elles aient le temps d’éclore. C’est précisément ce qui faisait sa puissance : en démocratisant la moquerie, elle devenait un outil ambigu, utilisable aussi bien par les progressistes que par les réactionnaires.
À mesure que la société s’échauffait : entre utopies sociales, réformes avortées et crispations conservatrices, la caricature gagnait en visibilité, jusqu’à se prendre elle-même au jeu. À partir de 1843, elle ne se contenta plus de parodier les Salons : elle organisa les siens. Preuve que le rire, lorsqu’il se fait outil, peut devenir forme autonome, et même contre-pouvoir. Derrière le trait acéré se dessinait, en creux, une critique plus vaste du monde tel qu’il va et telle que la bohème, depuis la Brasserie des Martyrs, rêvait de le renverser.
Comme bien des élans progressistes, l’art de la caricature appliqué à soi-même sort meurtri de la répression sanglante qui suit la Commune. Le gouvernement d’Adolphe Thiers n’est resté dans l’histoire ni pour sa clémence, ni pour son sens de l’humour. Pourtant, aucune botte, aucun chapeau haut-de-forme, si noir et rigide soit-il, ne saurait étouffer durablement ces pulsions irrépressibles qui forment une part non négligeable de l’humanité et l’autre, essentielle, de toute sociabilité : le rire.
Revers nécessaire
Le rire, et avec lui le cri (brutal, indécent, viscéral) dit le refus. Refus du sérieux de l’économie, de l’indignité du travail, de la marche prétendument irrésistible du progrès. Cri du besoin d’échapper à la norme, de s’extraire du rang, de s’encanailler. Ce besoin-là n’est ni accessoire ni décoratif : il est le revers nécessaire de tout ordre social, son trouble-fête et son antidote. Et la caricature, quand elle ne cède pas à la facilité ou à la haine, en reste l’un des instruments les plus puissants.
Fondations
À leur manière flamboyante, Théophile Gautier, Henri Murger, Petrus Borel ou encore les caricaturistes du Second Empire furent de véritables décrocheurs. Non pas des marginaux par défaut, mais des dissidents par choix. Ils n’ont pas simplement fui le monde bourgeois : ils l’ont tourné en dérision, s’en sont moqués à gorge déployée, et ont inventé d’autres façons d’habiter le langage, le temps et les relations. Leurs vies, souvent cabossées, parfois tragiques, n’en furent pas moins traversées par une exigence esthétique radicale : celle de faire de l’existence elle-même une forme, un geste, une provocation.
En cela, ils ne sont pas seulement les ancêtres pittoresques de nos contre-cultures : ils en sont les fondations profondes. Leurs refus, leurs extravagances, leurs satires, loin d’être de simples échappatoires, furent des actes de construction : construction d’un autre possible, plus libre, plus intense, plus désintéressé. Ils décrochaient, non pour fuir le monde, mais pour mieux lui opposer une vision affranchie de ses dogmes : une promesse de liberté qu’il nous revient, aujourd’hui encore, d’interroger.
La Commune de Paris
Utopie artistique
La bohème des années 1830, celle de Borel, de Gautier, de Murger, avait rêvé Paris comme un théâtre incandescent où la vie devait être vécue à la hauteur de l’art, dans la révolte contre l’ordre bourgeois, la pauvreté choisie, les amours orageuses et la poésie jetée à la face du monde comme une torche.
À la Brasserie des Martyrs, ce rêve s’était cristallisé dans les vapeurs d’absinthe, les éclats de rire et les querelles de style, mais aussi dans une fraternité réelle, précaire, où se formait la conscience, encore confuse, qu’une autre manière d’habiter la ville était possible, que de vivre en marge et de résister pouvait être enviable.
Fédération
Quarante ans plus tard, dans le tumulte de la Commune, ce rêve trouva un écho inattendu, soudainement précis, dans les décisions de la Fédération des Artistes, qui appela les créateurs à s’organiser eux-mêmes, à défendre leurs musées, à inventer un art libre, populaire, intégralement émancipé de la tutelle de l’État. Ce fut comme si l’ombre rieuse de Murger croisait le pas décidé de Courbet, comme si la bohème, sans l’avoir su, avait préparé le terrain d’une insurrection esthétique et politique, dont la Commune allait oser faire l’expérience, brève et ardente.

A ffiche de la Commune de Paris du 14 avril 1871
Autorisation donnée à Gaillard père de construire des barricades dans le XXe et le Ier Gallica/Bibliothèque Nationale de France
Quand éclate la Commune de Paris, le 18 mars 1871, des artistes adhèrent immédiatement à cet élan populaire qui semble contenir mieux qu’une promesse : une possibilité. Depuis des décennies déjà, ils s’étaient petit à petit retirés du monde officiel, désertant les salons, refusant les honneurs, préférant les clartés changeantes de la forêt de Fontainebleau à l’éclat compassé des palais parisiens. À Barbizon, à Chailly, ces « décrocheurs » avaient rêvé d’un autre art, d’une autre société, tandis qu’à la Brasserie des Martyrs leurs homologies littéraires avaient hurlé la mort d’un monde ancien. Voilà que la Commune leur offrait à tous un terrain d’expérimentation inespéré : une cité libre, affranchie du joug impérial et des structures figées du pouvoir académique. Enfin, le monde leur semblait prêt à entendre ce qu’ils avaient à dire – sur l’art, sur la vie, sur l’avenir.
Le réalisme trouve alors son terrain d’expression idéal. Il ne s’agissait plus simplement de représenter la vie du peuple, mais de une prendre part engagée à son émancipation. Pour Gustave Courbet, figure majeure de ce courant, la Commune ne fut pas une parenthèse mais une éclosion : Il faut concourir à la reconstitution de l’état moral de Paris et au rétablissement des arts qui sont sa fortune, écrit-il. Et d’ajouter : L’art n’est pas un luxe, il est une nécessité sociale.
La réponse des artistes faite au peuple insurgé fut immédiate et massive. Catulle Mendes critiquera vertement la forme de cette assemblée, mais le 13 avril, au milieu les heures sinistres du siège, du doute, des combats et des réconciliations déjà impossibles, plus de 400 d’entre eux se réunissent dans le grand amphithéâtre de l’École de médecine et contribuent à forger l’espoir de la Commune. Ils fondent la Fédération des artistes de Paris, autour d’un manifeste rédigé par Eugène Pottier (ouvrier, poète, futur auteur de L’Internationale). Ce texte proclame la libre expansion de l’art, dégagé de toute tutelle gouvernementale et de tous privilèges, et affirme que par la parole, la plume, le crayon, par la reproduction populaire des chefs-d’œuvre […], le comité concourra à notre régénération […], aux splendeurs de l’avenir et à la République universelle. Dégagé, populaire, régénération : trois mots devenus familiers qui passent aux actes, tout prêts à faire programme.

Théophile Alexandre Steinlein (1859-1923)
illustration pour l’édition de 1902 de L’Internationale
Musée d’Histoire Vivante de Montreuil
Il ne s’agissait plus seulement de faire de l’art, mais de le placer au cœur de la transformation sociale. Sous l’impulsion de Courbet et de Pottier, la Fédération se donne trois grandes missions: conserver les trésors du passé, mettre en lumière les forces du présent, et régénérer l’avenir par l’enseignement.
L’accès à la culture
L’art est un bien commun dont il est impérieux de transmettre les vertus sociales et poétiques dès l’école primaire, en organisant des cours populaires, en ouvrant largement les bibliothèques – tout en interdisant les prêts, afin d’éviter qu’une élite vienne s’y constituer des réserves privées. Les musées doivent être des lieux vivants, les théâtres des établissements d’instruction et non de profit. L’éducation artistique, rendue laïque, gratuite et obligatoire par Édouard Vaillant dès le 20 avril 1871, précède de quinze ans les lois Ferry (qui a pourtant été un ennemi déclaré de la Commune).
Sans subventions
L’autonomie revendiquée par la Fédération est sans précédent. Non seulement elle refuse la soumission à un art officiel, mais, au motif de soutenir l’indépendance des artistes sans laquelle ces derniers ne sont que des serviteurs, la Fédération propose de supprimer toute forme de subventions accordées aux artistes. Les institutions symboliques du régime impérial (l’École des beaux-arts, l’Institut) sont dans le viseur, et de fait : Bouguereau, Cabanel, Gérôme et Meissonnier, artistes officiels et officiellement entretenus par le Second Empire, s’opposeront à l’insurrection.
À la place des subsides, la Fédération offre le pouvoir et propose un gouvernement du monde des arts par les artistes eux-mêmes. Le 17 avril, dans l’ancienne salle du trône du Louvre, 290 artistes élisent une Commission Fédérale à bulletin secret : la démocratie directe investit les lieux de l’ancien pouvoir.
Pour l’historienne Kristen Ross, cette utopie artistique s’incarne dans l’idée de luxe communal, une expression qu’elle définit ainsi : une beauté publique, partagée, destinée à embellir les rues, les écoles, les jardins ; le droit pour chacun de vivre et de travailler dans un environnement agréable. L’art n’est plus l’apanage des élites : il devient un droit fondamental, un instrument d’émancipation, un outil de transformation collective, et ses effets débordent largement des limites du cadre : l’art a bel et bien à voir avec le travail comme avec l’environnement qui doit être propice à l’épanouissement de la communauté. L’art est la vie de la collectivité.
En ce sens, la Commune est bien l’aboutissement d’un rêve ancien. Depuis les années 1830, les artistes réalistes s’étaient insurgés contre l’académisme, contre l’instrumentalisation du beau à des fins de pouvoir. Courbet lui-même, en refusant la Légion d’honneur, affirmait déjà que l’art ne pouvait être l’ornement de l’État. Dans la forêt de Fontainebleau, les peintres avaient appris à voir et à vivre autrement – à célébrer le monde tel qu’il est, à l’écart des conventions, en établissant une continuité entre les œuvres et les existences, on parlera plus tard de Gesamtkunstwerk . La Commune fut, en quelque sorte, la transposition politique de ce geste esthétique. Une tentative de faire entrer la peinture dans la cité, de faire coïncider l’œuvre et la vie.
Cette effervescence fut brisée net. Les Versaillais, incapables de supporter ce rêve, y mirent un terme dans le sang. Lors de la Semaine sanglante (21-28 mai), la Commune est écrasée, ses acteurs fusillés, déportés, réduits au silence. Courbet, accusé d’avoir participé à la destruction de la colonne Vendôme, est emprisonné, ruiné, condamné à l’exil.
Mais l’idée, elle, survécut. Un sculpteur ayant participé à la Fédération des Artistes déclarera plus tard : Les résultats de nos propositions ont été grands. Non pas parce qu’elles ont élevé le niveau de l’art, mais parce qu’elles ont répandu l’art partout. De cette utopie brisée sont nées des vocations nouvelles : celles d’un art social, populaire, libéré du marché comme de l’État. Aujourd’hui encore, elle résonne dans les luttes de collectifs comme Art en grève ou La Buse, qui s’inscrivent dans la lignée de cette brève, ardente tentative d’émancipation.
Car si la Commune fut écrasée, elle a offert aux artistes un moment de vérité. L’espace d’un printemps, ils ont entrevu ce que pouvait être un monde où l’art ne serait plus un privilège, mais une respiration commune. Une beauté partagée. Une clairière dans l’histoire.

Pierre Ambroise Richebourg (1810-1875)
Barricade au coin de la place de l'Hôtel de Ville et rue de Rivoli, avril 1871
tirage albuminé argentique, 10 x 11 cm
Metropolitan Museum of Art New-York, Inv. 1998.334.1
Modèle anarchiste
La Fédération des artistes de la Commune, en appelant à « la libre expansion de l’art, dégagé de toute tutelle gouvernementale et de tous privilèges », n’énonçait pas seulement un vœu esthétique, mais une vision du monde. Leur projet d’un gouvernement des arts par les artistes, fondé sur l’autogestion et l’éducation populaire, influencera bien au-delà de 1871 les utopies artistiques et les tentatives de réinventer la vie.

Louis-Ernest Pichio, dit Ernest Picq (1826-1893)
La Veuve du Fusillé devant le Mur des Fédérés
peinture à l’huile sur toile, 148 x 113 cm, 1877
Musée de l’Histoire Vivante de Montreuil
La Commune de Paris, dans son refus de toute centralisation autoritaire, dans son organisation par fédérations libres, dans son mépris pour les hiérarchies imposées, porte en elle ce que l’on pourrait appeler un modèle anarchiste de société.
Pierre Kropotkine, dans La Commune de Paris (1881), saluait en elle non pas un programme figé mais l’ébauche vivante de ce que pourrait être une société construite sur la coopération, l’émancipation, et la création libre : un idéal qu’on retrouve, sous des formes différentes, dans les colonies d’artistes nées après la défaite de 1871, de Worpswede à Dornach, de Gödöllő au Monte Verità.
Épiphanie
Là aussi, il s’agit d’habiter autrement, de créer à distance du marché, de recomposer les liens entre art, artisanat, nature et société. L’idéal de la Commune irrigue souterrainement ces tentatives, par sa critique du capitalisme bourgeois, par son aspiration à une éducation intégrale, et surtout par son refus de séparer l’art de la vie. Le mouvement Lebensreform, né en Allemagne dans les années 1880-1890, hérite de ces intuitions : il réclame, comme les artistes Communeux, une réforme des mœurs et du rapport au corps, une attention à la beauté dans les gestes quotidiens, et une communauté de vie fondée sur l’autonomie et la dignité.
Dans ces clairières utopiques du tournant du siècle, la mémoire de la Commune ne se nomme pas toujours — mais elle respire dans les formes : dans l’autogestion des écoles d’art alternatives, dans les cercles végétariens, dans les sociétés naturistes, dans l’architecture organique ou les danses libres. Comme si le rêve brisé de 1871 s’était mis à bourgeonner ailleurs, en silence, dans les interstices de la modernité.
Ainsi la Commune, à travers la Fédération des artistes, apparaît non seulement comme l’éphémère épiphanie des aspirations portées depuis Barbizon, mais aussi comme le point-source d’une modernité alternative, où l’art n’est plus le miroir d’un monde inégal, mais l’outil fragile et splendide d’une régénération collective.

Anonyme
Le Retour des Parisiens dans la Capitale en juin 1871
peinture à l’huile sur toile, 91 x 63 cm
Musée d’Aquitaine, Bordeaux, Inv. D 69.24.01
Courbet puni
l’État et l’insoumis
Au printemps 1871, Gustave Courbet entre dans l’histoire non plus seulement comme un peintre du peuple, mais comme un homme du peuple. Il prend fait et cause pour la Commune de Paris, rejoint le Conseil communal, est élu délégué aux Beaux-Arts et préside la Fédération des artistes — aux côtés de figures telles que Dalou, Vallès ou Gill. Loin d’être un vandale, il organise la protection du patrimoine : les fenêtres du Louvre sont blindées, l’Arc de Triomphe et la fontaine des Innocents sécurisés, la collection privée de Thiers lui-même – porcelaines de Chine comprises – mise à l’abri. Courbet défend l’art, même celui de ses ennemis.

Bruno Braquehais (1823-1875)
Statue de Napoléon 1er à terre
après la mise à bas de la colonne Vendôme pendant la commune de Paris
papier albuminé, mai 1871
Bibliothèque Nationale de France
Courbet est probablement le barbu à l’arrière-plan dans le tiers droit de la photographie.
Mais son nom sera associé, à tort, à un acte spectaculaire : la chute de la colonne Vendôme. Érigé par Napoléon Ier, ce monument de bronze — moulé dans le métal des canons ennemis — trônait comme une relique impérialiste au cœur de Paris. Le 12 avril 1871, la Commune décrète sa démolition, dénonçant un symbole de barbarie, de force brute, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus. Courbet n’était pas présent lors du vote. Il avait jadis évoqué son retrait, oui, mais ce jour-là, il ne siège pas. Le 16 mai, quand la colonne s'effondre sur ordre de Félix Pyat, Courbet n’est pas non plus sur la place, selon plusieurs témoins directs. Mais le lendemain, il s’y rend, pose en souriant devant les débris. Cette image fera le tour de l’Europe : elle scelle sa légende de "déboulonneur", et scelle aussi sa chute.
Car la République des Versaillais ne lui pardonnera rien.
Lorsque la Commune est écrasée dans le sang, Courbet démissionne de ses fonctions, écœuré par l’exécution sommaire de son ami Gustave Chaudey. Arrêté le 7 juin, il est incarcéré à la Conciergerie, puis à Mazas. Dans une lettre au Rappel, il réaffirme son proudhonisme et sa foi dans l’auto-organisation sociale : J’ai lutté contre toutes les formes de gouvernement autoritaire […], voulant que l’homme se gouverne lui-même selon ses besoins. Mais cette voix, on veut la faire taire.

Gustave Courbet (1819-1877)
Autoportrait à Sainte-Pélagie
peinture à l’huile sur toile, 92 x 73 cm, 1871
Musée Courbet, Ornans, Inv. D 1976.1.7
Début août 1871, il comparaît à Versailles, devant le 3e conseil de guerre, en compagnie d’autres communards. Le verdict tombe le 2 septembre : six mois de prison, 500 francs d’amende, 6 850 francs de frais de procédure. Le motif officiel : avoir « provoqué la destruction de la colonne ». Courbet est condamné, sans preuve de sa responsabilité directe, pour l’exemple. À Sainte-Pélagie, il peint des natures mortes, dessine les femmes des fédérés emprisonnés. Le lion du réalisme devient prisonnier, digne mais brisé. Le 1er mars 1872, il recouvre la liberté. Et découvre l’ampleur de la haine.
La presse le couvre d’injures. Alexandre Dumas fils écrit que Courbet est une courge sonore et poilue, issu d’un accouplement fabuleux d’une limace et d’un paon. Mais l’humiliation ne s’arrête pas là. Les autorités le poussent à proposer, naïvement, de financer la reconstruction de la colonne avec la vente de ses tableaux. Il le regrettera. La lettre, destinée à amadouer ses juges, devient un piège.
En 1873, Mac Mahon signe un décret présidentiel exigeant de Courbet le remboursement intégral des frais de reconstruction de la colonne. L’addition est astronomique : 323 091 francs. C’est une condamnation à la ruine. Il n’est plus un peintre, il est un débiteur perpétuel. Un paria. Alors il fuit. S’exile en Suisse, à La Tour-de-Peilz, sur les bords du Léman. Il y mourra le 31 décembre 1877, rongé par la maladie, trois jours avant que le premier versement ne lui soit officiellement réclamé.
Ce que l’État versaillais a fait subir à Courbet n’était pas un simple règlement de comptes. C’était un avertissement. Une démonstration de force. L’impérial priape devait être redressé ; et l’artiste insoumis, brisé. En détruisant Courbet, on punissait le rêve — celui d’un art libre, d’une communauté d’égaux, d’une république sociale et fraternelle. Courbet avait incarné une vérité brutale, inacceptable pour l’ordre moral : celle d’un peuple qui se gouverne lui-même et ose abattre ses idoles. Il n’a pas détruit la colonne Vendôme ; il en a signé l’idée. Et si cela a suffi pour le rendre coupable il faut alors lui permettre de faire un bond dans l’histoire de l’art en lui attribuant cette toute première œuvre conceptuelle.
Ligne de conduite
Gustave Courbet appartient de plein droit à la constellation des Décrocheurs. Non pas comme un bohème velléitaire ou un esthète en rupture de ban, mais comme un homme qui, jusqu’au bout, a assumé de vivre en accord avec ce qu’il peignait : la matérialité nue des choses, la dignité des corps, l’irréductible souveraineté de l’individu. Né dans un siècle corseté par les académies, les empereurs et les faux-semblants, il a quitté la route toute tracée : celle d’un artiste reconnu, décoré, digéré par le régime, pour s’engager dans un autre récit : celui de la vérité sans fard, de l’autonomie artistique, de la fraternité insurgée. En refusant de se plier à l’ordre moral, Courbet n’a pas seulement déboulonné une colonne, il a fait trembler l’édifice. Son exil, son silence final, son entêtement à vouloir faire de l’art une affaire populaire et politique, en font un ancêtre évident de ceux qui, depuis le milieu du XIXe siècle, auront tenté de faire de leur vie une œuvre (et de leur œuvre, un acte de refus). Chez lui, décrocher n’était pas une posture, c’était une ligne de conduite.
Sa trajectoire, parabole tragique, résonne encore. Car elle annonce déjà les artistes dissidents, les colonies d’utopie, les réformateurs de vie qui, dans les décennies suivantes — de Worpswede à Monte Verità, des Lebensreformers aux anarchistes pacifistes — tenteront à leur tour de concilier création et autonomie, beauté et refus. Tous sont, à leur manière, des héritiers de Courbet.
Gustave Courbet, puni comme on punit les insoumis, n’aura pas reconstruit la colonne. Mais il aura dressé autre chose : un modèle d’indépendance.
Edgar Degas
anarchiste du regard
Impressionniste ? Il s’en serait presque offusqué. Edgar Degas n’aimait ni les étiquettes ni les groupes, encore moins les mots qui figent, qui rangent, qui réduisent. Bien avant qu’un critique d’art les affuble pour les railler d’Impressionnistes, proposa pour le groupe un autre titre : Les Intransigeants. Cela donne le ton. Degas, c’est l’inflexible, l’aigre, le solitaire sarcastique, à la fois classique et révolutionnaire, héritier d’Ingres et frère de Zola. Il n’appartient à rien, pas même au monde.
Né à Paris en 1834, Edgar Hilaire Germain de Gas ( il ne contractera son nom qu’après la guerre de 1870) vient de la grande bourgeoisie. Père banquier napolitain, mère créole de Louisiane, un univers de confort et de bienséance. Mais dès l’adolescence, l’homme se cabre. On le destine au droit, il se destine à l’art. Il préfère les maîtres anciens aux discours juridiques, les dessins du Louvre aux plaidoiries de la Sorbonne. Il abandonne sans regret ses études et aménage sous les combles un atelier glacial, qu’il habite comme un ermite. Déjà, la rupture est là : contre son milieu, contre sa classe, contre sa route toute tracée. La misanthropie naît souvent du trop-plein de promesses.
L’ascèse du dessin
Degas n’a jamais été un peintre spontané. Sa peinture n’est due qu’à sa seule volonté. Il est un travailleur, et pour peindre, il faut travailler:
L’art, c’est le travail. Le génie, c’est le travail.
Il entre aux Beaux-Arts en 1855, sous la direction de Louis Lamothe, ancien élève d’Ingres. Tout, chez Degas, respire l’obsession du trait juste. Il rencontre Ingres lui-même, lui montre ses dessins. Puis il part pour l’Italie (1856-1859) : Florence, Rome, Naples : il y copie Botticelli, Raphaël, Ghirlandaio. Mais ce n’est pas le pittoresque qui l’attire – c’est la construction, la tension, le silence des fresques. C’est là qu’il peint La Famille Bellelli, portrait âpre, crispé, où les regards ne se croisent pas. L’intimité, chez Degas, est une scène de théâtre – tendue, feutrée, froide.
1Cité par George Moore dans Memoirs of My Dead Life, 1906
2Louis Lamothe (1822-1869), peintre français, il aura également pour élèves James Tissot (de 1856 à 1859) et Henri Regnault (de 1861 à 1863).

Edgar Degas (1834-1917)
La Famille Bellelli
peinture à l’huile sur toile, 200 x 250 cm, 1859
Musée d’Orsay, Paris, Inv. RF 2210
L’œil et la guerre
Degas revient à Paris au début des années 1860. Fréquente le Café Guerbois, croise Manet, Zola, Bazille, Pissarro. Le verbe est vif, les joutes féroces. Degas y brille par ses aphorismes cruels, son élégance glacée, sa supériorité dessinée. Il n’a ni la chaleur de Renoir ni la ferveur de Monet. Il est là, mais ailleurs. Ce n’est pas le paysage qui l’intéresse, c’est la figure humaine, le mouvement, les gestes. Tandis que ses confrères s’en vont planter leurs chevalets au bord de la Seine, lui s’enfonce dans les coulisses de l’Opéra ou les paddocks de Longchamp. Il traque les danseuses, les acrobates, les blanchisseuses, les jockeys. Il observe, note, travaille.
Et pourtant, en 1870, quand la guerre franco-prussienne éclate, il s’engage. Artilleur dans la garde nationale, il obéit à un certain Ernest Meissonier, peintre académique, ennemi intime de Manet. Degas le méprise et le lui fait savoir : ses œuvres sont froides, mortes, sans spontanéité – curieux paradoxe, venant de lui. Mais ce n’est pas la technique qu’il lui reproche, c’est l’absence de vie. Car si Degas travaille lentement, c’est parce qu’il cherche l’âpreté du réel.
Le refus du réel bourgeois

Edgar Degas (1834-1917)
Le Bureau de coton à La Nouvelle-Orléans
peinture à l’huile sur toile, 74 x 92 cm, 1873
Musée des Beaux-Arts de Pau, Inv. 878.1.2
Après la guerre, Degas part à Londres, puis en Louisiane chez son frère. Il y peint Le Bureau de coton à La Nouvelle-Orléans, scène commerciale d’une rare sécheresse, qui semble se dérouler dans un silence de plomb – presque documentaire. L’œuvre entre dans les collections publiques françaises : c’est une reconnaissance. Mais Degas s’en fiche. Il ne court pas après les honneurs. Toute sa vie, il refusera décorations et académies. Il veut peindre librement, sans contraintes, sans clients.
En 1874, il participe à la première exposition impressionniste. Il en sera un pilier, sans jamais en être l’âme. Il expose sept fois sur huit, mais toujours en électron libre. Il ne peint jamais sur le motif. Il déteste la nature. À Monet qui s’extasie devant la lumière du matin, il répond froidement :
À vous, il faut la vie naturelle, à moi la vie factice.
La lumière, pour lui, c’est celle des lampes à gaz. Son soleil à lui, c’est la rampe de l’Opéra, les chandelles des loges, les ombres sales des arrière-salles. Il peint ce que les bourgeois ne veulent pas voir : les corps fatigués, les gestes machiniques, la douleur des postures.

Edgar Degas (1834-1917)
Repasseuses
legs Camondo, peinture à l’huile sur toile, 76 x 81 cm, 1886
Musée d’Orsay, Inv. RF 1985
Les petits rats et les grands cyniques
C’est dans les années 1870-80 que Degas s’enferme dans l’univers du ballet. Il devient abonné de l’Opéra, pas tellement pour en admirer les spectacles, mais plutôt pour en explorer les coulisses. Il étudie les petits rats : enfants pauvres, formées dès l’enfance, jetées en pâture à la lubricité des abonnés en haut-de-forme, des petits rats, en effet. Il peint les contorsions, les massages de cheville, les bretelles qui tombent. Il scrute la misère derrière la féerie. À sa manière, il dissèque un marché du corps sans jamais le dénoncer explicitement. Degas n’est pas un moraliste, mais un scalpel.

Edgar Degas (1834-1917)
Petite danseuse de quatorze ans
cire d'abeille pigmentée, argile, armature métallique, corde, pinceaux, cheveux humains, ruban de soie et de lin, corsage en faille de coton, tutu en coton et soie, chaussons en lin, sur socle en bois, 99 x 34 x 35 cm, 1881
version de la national Gallery of Art, Washington D.C., Inv. 1999.80.28
Sa Petite Danseuse de quatorze ans, présentée en 1881, choque le public de l’époque, et n’irait sans doute pas sans poser quelques problèmes aujourd’hui. Sculpture en cire, vêtue d’un vrai tutu, avec ses cheveux noués d’un ruban. On la trouve laide, grotesque, vulgaire. Trop vraie. Pas assez idéalisée. Pas assez artistique. Degas montre ce que les autres maquillent : le travail, la tension, l’enfance offerte. On lui reproche de déshonorer la grâce. Il n’en a cure. Il avance.
Le faux impressionniste
Ce qui le rattache au groupe impressionniste, ce n’est ni la technique, ni les sujets, ni même les idées. C’est l’esprit frondeur. Comme eux, il rejette l’académisme, l’autorité, les cadres et trop de code. Mais là où Monet improvise, Degas structure. Là où Renoir caresse, Degas dissèque. Il compose ses tableaux comme un metteur en scène. Il découpe l’espace, coupe les figures, excentre les corps. L’Absinthe (1876), c’est comme le portrait d’une junkie, la peinture d’une déchéance où le malaise s’installe aussi entre les arrêtes et les angles des plans flottants des tables prêtes à trancher l’affaissement vertical des protagonistes.

Edgar Degas (1834-1917)
Dans un Café - L’Absinthe
peinture à l’huile sur toile, 92 x 68 cm, 1876
Musée d’Orsay, Paris, Inv. RF 1984
Sa technique est lente, obsessionnelle. Il peint de mémoire, recomposant les gestes qu’il a retenus. Sa mémoire visuelle est prodigieuse. Il capte une inclinaison de cou, une cambrure de dos, une tension de cheville. Puis il reconstruit. Chaque toile est un mensonge exact.
La cécité, la solitude, la rage
À partir des années 1880, sa vue décline sérieusement. Il abandonne l’huile pour le pastel, plus rapide, plus malléable. Il y mélange la gouache et l’aquarelle. Puis il monte des figures, en secret, comme un aveugle qui modèle le monde avec ses mains. Il expose peu, refuse les hommages, s’aigrit. Il devient odieux, parfois odieux au carré. Ses réparties font mouche, mais blessent. Et puis survient l’affaire Dreyfus.
Degas prend parti contre Dreyfus. Il s’engage dans la Ligue pour la Patrie française, organisation antidreyfusarde. Il rompt avec Monet, avec Mary Cassatt, avec tous ceux qui défendent l’innocence du capitaine. Son antisémitisme éclate au grand jour. C’est une souillure indélébile. C’est la part maudite de cette misanthropie généralisée, de cette haine froide du genre humain qui habite l’homme autant que l’artiste.
Edgar Degas photographe
Dans le Paris des années 1890, alors que Degas atteint la soixantaine et que sa vue décline, l’artiste découvre la photographie avec une ferveur obsessionnelle. Entre 1894 et 1896, l’œil du peintre s’augmente de celui du photographe, composant avec soin amis, danseuses et nus dans des clichés comme autant de transferts de son vocabulaire picturale. Une parenthèse brève mais intense, qui éclaire d’un jour nouveau son approche de la lumière, du mouvement et de l’intimité.
Un œil en plus
Atteint de troubles oculaires, Degas trouve dans l’appareil photo le prolongement mécanique de sa vision défaillante. Jean Cocteau évoquera cette "dépendance à la photographie", tandis que Paul Valéry décrit dans des séances nocturnes éclairées à la lueur de "neuf lampes à pétrole". Loin des photographes pictorialistes dont il est le contemporain, Degas a une approche empirique de la photographie : il expérimente les poses longues, les doubles expositions accidentelles, et surtout la lumière artificielle, qu’il employait déjà dans ses toiles d’opéra ou de cafés-concerts.

Edgar Degas (1834-1917)
Pierre-Auguste Renoir et Stéphane Mallarmé
épreuve argentique, décembre 1895
New York, Museum of Modern Art, New-York, Inv. 207.1989
Ses modèles sont l’élite artistique de l’époque : Mallarmé, Renoir, ou Maeterlinck, saisis dans des compositions rigoureuses où chaque détail est chorégraphié. Le portrait de Renoir et Mallarmé résume cette esthétique : un clair-obscur dramatique, des regards fuyants, et le reflet spectral de Degas lui-même dans un miroir, et pourtant une photographie de champ-contrechamp, pétrie de réalisme par l’inclusion de son contexte.
Labo-Photo
Cette pratique confidentielle (une seule exposition de son vivant, chez Tasset, son marchand de couleurs en 1895) influence pourtant son œuvre tardive. Ses pastels et monotypes adoptent des effets de flou et de contre-jour typiquement photographiques. Comme le note Daniel Halévy, fils de ses amis Ludovic et Louise : Il voulait capturer cette atmosphère de lampes ou lunaire qui hantait ses toiles.

Edgar Degas (1834-1917)
Henri Rouart (1833-1912) industriel et collectionneur, chez lui, devant ses tableaux
épreuve argentique à partir d'un négatif sur verre au gélatino-bromure d'argent H. 37,5 ; L. 27,5 cm, 1895
Musée d’Orsay, Inv. PHO 2003 7
Un héritage paradoxal
En 1905, Degas confie dans une lettre à Daniel Halévy : La photographie, ça a été une passion terrible, j’ai ennuyé tous mes amis. Pourtant, ces clichés (moins d’une cinquantaine subsistent) constituent un jalon essentiel dans l’histoire de l’art. Ils anticipent les recherches sur la décomposition du mouvement (Muybridge, Marey), tout en affirmant la photographie comme acte créatif, non plus seulement technique.
Ultime paradoxe : celui qui méprisait les "amateurs" comme Zola ou Bonnard livre avec son appareil une œuvre aussi aboutie qu’éphémère.
Ruine et errance
Degas cesse toute activité artistique en 1911. Il est presque aveugle, ruiné par de mauvaises affaires familiales. Il ne vend plus. Il n’expose plus. Il vit au milieu de ses collections : cinq cents tableaux, parmi lesquels des œuvres de Ingres, de Delacroix ou de Forain, et pas moins de cinq mille gravures. Misanthrope solitaire et cassant, Degas meurt à 83 ans, d’un anévrisme.
L’année suivante, sa collection est dispersée. Tout ce qu’il avait réuni est vendu. Comme un pied de nez à l’ordre bourgeois : rien ne dure, tout doit un jour être dispersé.
Un anarchiste sans cause
Degas, c’est l’intransigeance faite homme. Il n’a jamais fait de concessions. Ni pour vendre, ni pour séduire, ni pour appartenir. Il a peint la douleur sans pathos, le travail sans morale, la société sans fard. Il n’était ni tendre, ni sympathique, ni rassembleur. Mais il fut exact. Il a vu, sans cligner. Il a dit, sans trembler l’âpreté du verso de ce qui semblait si charmant.
S.A.C.A.P.S.G.
La Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs :
une révolution entrepreneuriale dans l’art
Sans Salon, point de salut !
Pour un jeune artiste au XIXᵉ siècle, la véritable reconnaissance passait obligatoirement par le Salon. Créé en 1667 par Colbert et d’abord réservé aux élèves de l’Ecole des Beaux Arts, il s’ouvrit à tous après la Révolution, avec un jury chargé de sélectionner les œuvres. Devenu annuel à partir de 1833, le Salon exposait jusqu’à quatre mille tableaux, attirant un public immense (parfois quatre mille visiteurs par jour) et constituant le plus grand marché de l’art contemporain au monde.
Le Salon n’était pas seulement une vitrine : il offrait aux artistes une chance unique de vendre, d’obtenir des commandes officielles, et de voir leurs œuvres acquises par l’État pour les musées et bâtiments publics. La presse en faisait un événement majeur, relayé par des critiques de poids comme Baudelaire, Zola, Gautier ou les frères Goncourt, et par des revues satiriques comme Le Charivari, avec les dessins acérés de Daumier et les sarcasmes de Cham.
Mais derrière le prestige se cachait un système verrouillé : les jurés, souvent conservateurs, privilégiaient les académistes et fermaient la porte aux artistes les plus novateurs. Le Salon incarnait ainsi à la fois le sommet de la reconnaissance officielle et le carcan contre lequel allaient bientôt se frotter les avant-gardes.
Le Salon des Refusés, 1863
En 1863, le jury du Salon rejeta près de quatre mille œuvres — non seulement celles des jeunes autour de Manet, mais aussi celles de peintres conformistes posant moins de difficultés esthétiques. Le scandale fut tel que Napoléon III en personne vint inspecter les toiles recalées. Ne voyant aucune différence avec celles retenues, il ordonna qu’on ouvre, à côté du Salon officiel, des salles pour exposer les refusés : le public jugerait.
La décision fut vécue comme une insulte par les jurés, et même par de nombreux recalés, qui refusèrent d’être associés aux « brebis galeuses ». Mais Manet, Fantin-Latour, Whistler, Cézanne, Pissarro ou Guillaumin saisirent l’occasion, convaincus que le public reconnaîtrait leur valeur. Ils se trompaient : le public riait, et les critiques accablaient. Pour beaucoup, le Salon des Refusés était seulement une attraction comique.
Au milieu de la curiosité et des moqueries, Le Déjeuner sur l’herbe de Manet provoqua un choc. Ce n’était pas tant la modernité du sujet que l’audace d’un nu féminin assis parmi des hommes en habits contemporains qui heurta la morale bourgeoise. De même, Whistler scandalisa avec son portrait Symphonie en blanc n°1, moqué jusque dans son titre.

James Abott McNeil Whistler (1834-1903)
Symphonie en blanc n°1 (La jeune fille en blanc : portrait de Joanna Hiffernan)
peinture à l’huile sur toile, 213 x 107 cm, 1863
National Gallery of Art, Washington D.C., Inv. 1943.6.2
Pour Manet, pourtant, l’humiliation se transforma en éclat : conspué mais désormais célèbre, il entra dans l’histoire.
L’atelier de Nadar
Le 27 décembre 1873, dans l’atelier parisien du photographe Nadar, un acte fondateur se joue, discret mais déterminant. Monet, Renoir, Degas, Pissarro, Sisley et quelques autres signent les statuts de la Société anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Derrière ce nom administratif se cache un geste d’une audace inédite : créer une structure juridique et financière capable de contourner le monopole de l’Académie des Beaux-Arts. Ce jour-là, ces artistes, souvent rejetés par le Salon officiel, ne se contentent pas de protester contre le système : ils inventent un outil pour le défier.
Une réponse pragmatique à une exclusion systématique
L’initiative naît d’un constat simple : sans accès au Salon, point de visibilité, donc point de ventes. Plutôt que de dépendre de mécènes ou de galeristes isolés, les artistes optent pour un modèle coopératif, mutualisant leurs ressources et leurs risques. La charte prévoit que la société prélèvera 10 % sur les ventes réalisées lors de leurs expositions, une somme destinée à financer les projets futurs. Ce mécanisme, inspiré des coopératives ouvrières alors émergentes, transforme l’art en une entreprise collective. Comme le note Pissarro dans une lettre à son fils Lucien : "Sans cette discipline, nous ne serions qu’une bande de rêveurs. La coopérative nous oblige à compter, à prévoir, à durer."

Statuts de la Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs etc... à Paris Chronique des Arts et de la Curiosité, 17 janvier 1874
Le choix du lieu d’exposition est tout aussi stratégique. Le dernier étage des vastes ateliers de Nadar au 35 boulevard des Capucines, offre une lumière zénithale idéale pour accrocher les toiles, et Renoir profite de l’occasion pour se libérer d’un usage qui le pèse : les tableaux ne seront pas accrochés partout où cela est possible (les grands en haut et les petits en bas) mais au maximum sur deux rangées superposées et, lorsque c’est possible, on veillera à laisser quelque intervalle entre les tableaux afin de réserver aux tableaux l’espace qu’ils méritent et au visiteur le confort nécessaire à sa visite.
Le choix de ces ateliers symbolise aussi une modernité assumée, ils se trouvent au centre de la carte de la vie parisienne de l’époque, et . Nadar, photographe anticonformiste et ami des avant-gardes, incarne l’alliance entre art et innovation technique. Degas, avec son ironie mordante, propose de baptiser la société "La Capucine", en référence à l’adresse et à une chanson révolutionnaire. L’idée est rejetée : trop provocante à l’heure où le groupe cherche à conquérir un public encore méfiant, mais elle révèle l’esprit frondeur qui anime l’entreprise.
Un outil juridique au service de l’indépendance artistique
La forme juridique de société anonyme coopérative n’est pas anodine. Elle permet aux artistes de :
-
S’émanciper des réseaux traditionnels (Salon, Académie, mécénat aristocratique) ;
-
Bénéficier d’une personnalité morale, leur donnant le droit de signer des contrats, de louer des espaces, et de percevoir des revenus collectifs ;
-
Instaurer une gouvernance démocratique, où chaque membre, qu’il soit Monet ou un jeune inconnu, dispose d’une voix égale.
Cette structure préfigure les modèles contemporains de artist-run spaces. Elle anticipe aussi les tensions futures entre indépendance créative et logique marchande, comme le soulignera Pissarro bien plus tard :
"Nous avons cru échapper au jury du Salon pour être jugés par les billets de banque. Est-ce vraiment mieux ?"(Pissarro)
La main de Durand-Ruel et les limites du modèle

Marcellin Desboutin (1823-1902)
Portrait de Paul Durand-Ruel
gravure, 1882
Si la Société Anonyme Coopérative est une initiative d’artistes, elle ne peut ignorer l’influence des marchands. Paul Durand-Ruel, déjà soutien discret de Monet et Pissarro, joue un rôle ambigu : il finance partiellement l’exposition de 1874 (notamment via des achats anticipés), mais refuse de s’afficher publiquement, craignant de compromettre ses relations avec l’establishment. Son pragmatisme commercial contraste avec l’idéalisme des coopérateurs. Degas, méfiant, dénoncera bientôt ce qu’il perçoit comme une mainmise du marché sur l’art.

Catalogue de la première exposition de la Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs etc... du 15 avril au 15 mai 1874
35, boulevard des Capucines, Paris
La dissolution de la société en octobre 1874, après seulement dix mois d’existence, acte ses limites : malgré 3 500 visiteurs payants, l’exposition est un échec financier, et les dissensions internes (notamment sur la participation de Cézanne) fragilisent le groupe. Pourtant, l’expérience aura prouvé une chose essentielle : des artistes peuvent s’organiser en dehors des institutions, inventer leurs propres règles, et conquérir la liberté que le Salon leur refusait.
Héritage : la coopérative comme acte politique
En se dotant d’un outil juridique et financier, les impressionnistes ont fait bien plus qu’organiser une exposition. Ils ont :
-
Légitimé l’auto-gestion dans un milieu où l’artiste était traditionnellement soumis aux commanditaires ;
-
Inventé un nouveau rapport à l’économie de l’art, où la mutualisation des ressources permet de contourner les gardiens du temple (et les chiens de garde) ;
-
Posé les bases des sécessions futures, de la Sécession viennoise aux collectifs d’artistes contemporains.
Comme l’écrivait encore Pissarro : Nous avons fait plus que peindre autrement — nous avons prouvé qu’on pouvait exister sans leur permission. La Société Anonyme Coopérative, éphémère mais visionnaire, reste un modèle entrepreneurial mis au service de la résistance, où l’audace artistique et l’ingéniosité organisationnelle se conjuguent pour défier l’ordre établi.
Cette stratégie : s’approprier les outils et la grammaire même de l’ennemi pour les détourner au service d’un projet alternatif, deviendra la signature de la Lebensreform. Sur le Monte Verità, Henri Oedenkoven n’aura pas d’autre méthode pour faire du Sanatorium l’incarnation concrète d’une révolution douce. Là, entre murs blancs et jardins en terrasses, il retournera les codes de la médecine traditionnelle et du capitalisme naissant pour en faire les instruments d’une émancipation radicale.
Paris après la Commune
renaissance artistique et subversion des cabarets montmartrois

Jean-Jules Andrieu (1816-1876)
L’Hôtel des Finances du Mont-Thabor, rue de Rivoli, mai 1871
Musée Carnavalet, Paris, Inv. PH4393
À la fin mai 1871, les Parisiens reviennent dans une capitale dévastée et meurtrie. La "Semaine Sanglante" a laissé des plaies visibles : édifices détruits, rues marquées par les barricades, et une répression féroce qui s’abat sur les communards. Exécutions, déportations, annulation des réformes sociales… La IIIe République naissante, sous Thiers puis Mac Mahon, impose un "ordre moral" et efface méthodiquement les traces de l’insurrection.
238 bâtiments ont été incendiés ou détruits pendant la Commune. Dont : le palais des Tuileries, le palais de la Légion d'honneur, le palais d'Orsay, la Caisse des dépôts, le Palais de justice, la bibliothèque impériale au Louvre, le Palais-Royal, l'Hôtel de ville, la Conciergerie, la Préfecture de police, l'église de Bercy, le temple protestant de la rue Saint-Antoine et la mairie du 12e arrondissement, mais également des lieux de spectacles comme le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le Théâtre-Lyrique et le théâtre des Délassements-Comiques[108] ou des bâtiments d'intérêt économique comme les docks de La Villette ou la manufacture des Gobelins. Des feux sont également allumés dans de nombreuses maisons qui jouxtent les barricades des insurgés, rue Saint-Florentin, rue du Faubourg-Saint-Honoré, rue du Bac, rue Vavin, place de l'Hôtel-de-Ville ou boulevard de Sébastopol.
Maxime du Camp, versaillais, parle de 6 562 morts, tandis que l’ancien Communeux Prosper-Olivier Lissagaray évoque 20 000 morts. Charles-Camille Pelletan, historie, situe autour de 30 000 le nombre de morts décomptés à l’issue de la Semaine Sanglante. Dans les rangs des versaillais, on dénombre jusqu’à 900 morts.

E ugène Disdéri (1819-1889)
Cadavres d’Insurgés dans leurs Cercueils
épreuve sur papier albuminé d’après négatif verre au collodion, 1871
Musée Carnavalet, Paris, Inv. PH9951
Dans l’ombre de cette reconstruction, une autre révolution se prépare – Littéraire cette fois.
Montmartre, laboratoire d’une contre-culture
Dès 1871, la contre-culture passe à l’offensive, mais par les mots cette fois. Face à un conservatisme bourgeois trop bien blindé, l’affrontement direct est impossible — il faut frapper là où il ne voit rien venir. Une poignée de poètes et d’écrivains s’engouffrent dans la brèche, transformant l’humour en arme de subversion. Les notables, dupes, prennent leurs attaques pour de simples farces, sans comprendre qu’ils se font démonter pièce par pièce. Ironie suprême : là où l’Ancien Régime maniait la moquerie avec élégance, les nouveaux riches de 1870, incultes et vaniteux, ne brillent que par l’épaisseur de leurs livrets de caisse. Le combat est lancé : retourner le langage contre leurs certitudes, pulvériser leurs dogmes sur l’art et le bon goût.

H enri Fantin-Latour (1836-1904)
Un Coin de Table
peinture à l’huile sur toile, 160 x 225 cm, 1872
Musée d’Orsay, Paris, Inv. RF 1959
présentés à l’arrière-plan, de gauche à droite : Elzéar Bonnier, Emile Blémont, Jean Aicard
assis au premier plan : Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, Léon Valade, Ernest d'Hervilly, Camille Pelletan.
Si Camille Pelletan n’est pas vêtu de noir c’est parce qu’il n’est pas un poète mais un homme politique
Les pionniers de cette guérilla verbale sont à trouver dans le Groupe des Vilains Bonshommes. Émanation du Cercle des Parnassiens, le groupe est composé notamment de Paul Verlaine, de Antoine Cros, de Henri Fantin-Latour, d’André Gill et de Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud s’y verra admis avant que se forme la dissidence qui prendra le nom de Zutistes, ouvrant la voie à toute une lignée d’irrévérencieux — Hydropathes, Fumistes, Incohérents — qui s’acharneront à faire sauter la syntaxe, le sens et les conventions artistiques sacrées.
Cet enchevêtrement des relations entre ces groupes, leurs connexions et influences mutuelles, forment un réseau si complexe qu'il semble déjouer toute volonté d'en tracer une histoire officielle et rectiligne. Si cette intrication est le fruit du hasard plutôt que d'une stratégie délibérée, elle n'en fonctionne pas moins comme un rempart préservant avec génie le précieux secret de cette contre-culture.
Aussi, au risque de commettre un sacrilège ou de froisser les puristes, mais dans le seul dessein de guider le lecteur (assez sage pour en préserver l'énigme), je présente ici un schéma de ces mouvements avant de les détailler dans les chapitres qui suivent.

Le Grand Soir
Ces lieux incarnent une utopie : réconcilier l’art et le peuple, sans tomber dans le didactisme. Jerrold Seigel note : Montmartre invente une bohème nouvelle, où l’élitisme créatif cohabite avec l’ivresse démocratique. Anarchistes et poètes maudits y croisent ouvriers et chômeurs et entretiennent sur le souvenir d’une révolution une nouvelle à venir, la bonne cette fois. Toulouse-Lautrec immortalise cette rencontre dans ses affiches de cabaret ; Aristide Bruant y dit les chansons argotiques qui feront la culture d’une audience médusée par les cris de bête sauvage produits par la Goulue qui déboule.
Art et anarchie : les réseaux de la subversion
L’effervescence des cabarets ne se limite pas à l’art. À deux pas du Chat noir, rue Bochart de Saron, le journal anarchiste L’Endehors de Zo d’Axa diffuse ses brûlots. Caroline Granier souligne que ces lieux ont permis la survie d’une pensée libertaire après la Commune. Une connivence tacite unit artistes et militants – partageant une même défiance envers l’État, mais aussi une même fascination pour la culture populaire.
Mais il faut se méfier des légendes. Comme l’a montré Louis Chevalier, la "bohème montmartroise" fut souvent mythifiée. Van Gogh n’y passa que quelques mois ; Modigliani y vécut misérablement, loin des paillettes du Lapin Agile. Derrière la postérité glamour des lieux, se cache une réalité plus âpre : des artistes précaires, des conflits entre courants, et une économie au bord de la faillite. Le quotidien de la Bohème Montmartoise n’a rien de drôle : c’est la misère crue, rien à voir avec la belle époque.
Entre ces groupes, les passerelles sont nombreuses mais piégées. Le Cercle Zutique donne naissance aux Hydropathes. De la dissolution de ces derniers émergent à la fois les Fumistes, les Incohérents et le Chat Noir. Pourtant, ces enfants nés d’un même ventre rient parfois aux dépens les uns des autres. Les Incohérents méprisent les Hydropathes qu’ils jugent trop littéraires. Les Fumistes crachent sur le Chat Noir qu’ils considèrent comme une vitrine pour bourgeois en mal de canaille. C’est une constellation de tensions, d’emprunts, de moqueries et de coups d’éclat.
Ce qui les unit malgré tout, c’est un rejet viscéral de l’académisme. Une haine du sérieux. Le culte du rire comme arme politique : surtout dans le climat post-répression de la Commune. Et quelques figures pivotent entre ces cercles : Charles Cros, le poète-inventeur, Jules Lévy, le provocateur prolifique, et bien sûr Alphonse Allais, passe-muraille du sarcasme.
Si l’on devait résumer en une phrase l’identité de chacun, on dirait que les Zutiques allument la mèche souterraine. Les Hydropathes organisent la fête. Les Fumistes soufflent la fumée. Les Incohérents montent une exposition. Le Chat Noir, enfin, ouvre une billetterie. Chacun à sa manière répond à la même question lancinante : comment faire de l’art quand on méprise l’Art ? Et dans leurs grimaces, leurs rires et leurs dérisions collectives, ils ont contribué, ensemble, à forger les premières armes de ce qu’on appellera bientôt la contre-culture.
Une esthétique de la provocation
Les cabarets inventent les formes inédites d’un spectacle total. Quand Salis organise le faux "déménagement du Chat noir" en 1885 : un défilé de chars grotesques à travers Paris, il éclate le cadre conventionnel du spectacle et intègre la ville la ville comme s’il s’agissait scène ouverte : c’est l’espace public qui est le cadre de cette œuvre. Les "Vachalcades" de 1896, parodies de carnavals avec des vaches lâchées dans les rues, brouillent les frontières entre art et canular. La taxinomie en prend un coup.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)
couverture pour la revue La Vache Enragée
lithographie, 1896
Héritage ambigu
Artistes, bohèmes, dessinateurs et cabaretiers ensauvagent la vie artistique parisienne durant les deux dernières décennies du XIXe siècle. De leur bouillonnement naît une culture à la fois populaire et sophistiquée, un ferment qui irriguera les avant-gardes jusqu’à l’époque des Yéyés, nourrissant l’utopie d’une alliance entre lettrés et peuple contre l’ordre bourgeois. Ces vingt années sont celles d’un Paris canaille, irrévérencieux, où la créativité élargit la mise en pièces formelle des cadres conventionnels en y introduisant des éléments conceptuels et langagiés inédits.
L’appréciation de ces éléments considérés comme précurseurs n’est d’ailleurs pas sans poser problème. On pourrait voir dans ces mouvements (Zutiques, Hydropathes, Fumistes et Incohérents) les inventeurs improvisés du monochrome, de Dada, du bruitisme, de Fluxus, voire même des Punks. Cet anachronisme découle naturellement de notre enthousiasme pour ces courants, ainsi que de l’impossibilité d’en retracer l’histoire sans la mêler à la nôtre. Prudence oblige, nous n’affirmerons pas qu’Alphonse Allais a "inventé" le monochrome avant son invention officielle ; nous préférerons leur attribuer, avec tout le prestige qu’ils méritent, le titre de « pères putatifs ». Reste que leur contribution essentielle ne doit pas être sous-estimée : Les Hydropathes et autres Fumistes ont bel et bien créé un art qui parle de l’art – un méta-art, ou un art méta-artistique. Une approche qui s’avère, en définitive, d’une pertinence remarquable pour saisir l’art du XXᵉ siècle.
Le Dernier Mot
Si la contre-culture maîtrise l’art de la subversion par le retournement, le pouvoir, lui, n’ignore rien de cet art. La preuve ? Aujourd’hui encore, quand l’école évalue la maîtrise du français chez les adolescents à travers l’œuvre de Rimbaud, elle veille soigneusement à ce qu’ils ignorent tout d’un certain sonnet…
Zut.
Le Cercle Zutique, microcosme va naître en 1871 à l’Hôtel des Étrangers, où Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Charles et Antoine Cros et autres esprits acérés dégainent parodies, insultes et grivoiseries. Le Sonnet du trou du cul résume l’esprit du groupe : rire noir, érotisme cynique et mépris affiché pour les Parnassiens bien-pensants.
Leur manifeste tient en un sonnet griffonné de quatorze signatures, dont celles des frêres Cros, Verlaine et Rimbaud, avec ce mot d’ordre :
Zut alors, si l’on nous emmerde !
L’Album Zutique sera le support des activités du groupe, sorte de livre de bord, fonctionnant à la fois comme un laboratoire ouvert aux expérimentations poétiques et un défouloir, dans lequel le Cercle caricaturait férocement les poètes parnassiens, par des poèmes parodiques ou érotiques et des dessins parfois très lestes, avec une attention soignée à l’endroit de François Coppée, véritable tête de turc du groupe. D'autres poètes « officiels » en prennent aussi pour leur grade et notamment Alphonse Daudet.
Ce qui frappe, à relire l’Album Zutique, c’est sa modernité. Les Zutistes n’inventent pas la subversion, mais ils en radicalisent les codes : mélange des genres (poésie et dessin), culte de l’éphémère (leurs textes ne sont pas destinés à la publication), et surtout, un humour qui fait office de bombe à fragmentation. Quand Rimbaud écrit Merde à Dieu dans un coin de page, ce n’est pas un blasphème d’adolescent : c’est un acte de sabotage linguistique. Leur cible ? La langue elle-même, ce français académique qui sert à glorifier l’ordre moral.
Recueil à charge de vers scatologiques et de croquis vengeurs, l’ Album Zutique sera le legs du cercle, contenant déjà le précieux ADN du Fumisme à venir.
Obscur et froncé comme un œillet violet
Il respire, humblement tapi parmi la mousse
Humide encor d’amour qui suit la fuite douce
Des Fesses blanches jusqu’au cœur de son ourlet.
Des filaments pareils à des larmes de lait
Ont pleuré, sous le vent cruel qui les repousse,
À travers de petits caillots de marne rousse
Pour s’aller perdre où la pente les appelait.
Mon Rêve s’aboucha souvent à sa ventouse ;
Mon âme, du coït matériel jalouse,
En fit son larmier fauve et son nid de sanglots.
C’est l’olive pâmée, et la flûte câline,
C’est le tube où descend la céleste praline :
Chanaan féminin dans les moiteurs enclos !
Paul Verlaine et Arthur Rimbaud
Poème inclus dans l’Album Zutique, 1872
Le groupe ne durera qu’un an. Dès l’été 1872, les défections s’accumulent : Rimbaud et Verlaine partent pour Londres, Albert Mérat (qui ne supportait pas le jeune Arthur) a déjà claqué la porte. Mais l’esprit zutique leur survivra. Charles Cros tentera de relancer le cercle en 1883, et l’Album, transmis comme une relique, finira entre les mains de Coquelin Cadet avant d’alimenter les enchères.
En 1938, l’avionneur Latécoère l’achète pour 25 000 francs : une somme folle pour un recueil de blagues graveleuses. Depuis, le manuscrit original, jalousement gardé (ou peut-être perdu), reste inaccessible aux chercheurs. Comme si, cent cinquante ans plus tard, l’establishment redoutait encore l’étincelle de ces vingt mois d’insolence.
Zbeul complet

Georges Lorin, dit Cabriol (1850-1927)
Caricature d ‘Émile Goudeau
L'Hydropathe, no 1 du 22 janvier 1879
Paris, octobre 1878. Dans un café enfumé de la rue Cujas, une trentaine de poètes, d'artistes et d'étudiants lèvent leur verre - de vin bien sûr, jamais d'eau - pour fonder le club le plus singulier du siècle : les Hydropathes. Leur nom ? Un savant mélange de grec ("ceux que l'eau rend malades") et de jeu de mots sur leur fondateur, Émile Goudeau ("goût d'eau" pour ces assoiffés de vin rouge). Leur credo ? Hydropathes, chantons en cœur / La noble chanson des liqueurs, écrira Charles Cros. Leur programme ? Aucun. Juste la volonté de créer un "anti-cénacle" où l'on puisse déclamer des vers entre deux rasades, loin des salons guindés et des écoles littéraires.
Pourquoi votre société a-t-elle pris le nom d'Hydropathe ?
demandait-on à l'un de nos confrères :
Parce qu'elle a Goudeau, et tient ses séances à l'hôtel Boileau.
Coup de comm’
Ce qui distingue les Hydropathes des autres groupes bohèmes, c'est leur génie de la communication. Dès janvier 1879, ils lancent leur revue, Les Hydropathes, véritable machine à fabriquer de la légende. Chaque numéro présente en couverture une caricature signée Cabriol (pseudonyme de Georges Lorin) mettant en vedette l'un des leurs : Sarah Bernhardt en sirène hydropathe, Charles Cros en alchimiste des rimes, ou le jeune Alphonse Allais en farceur patenté. À l'intérieur, on trouve les textes lus lors des séances du vendredi soir - des poèmes, des monologues, des chansons - et surtout, des comptes-rendus pleins d'autodérision : "La séance d'hier fut un peu vide... comme nos verres à la fin de la soirée !"
Le club connut un succès immédiat : dès sa première séance, il attira 75 personnes, avant de compter jusqu’à 300 à 350 membres. Cette popularité tenait autant au charisme de son président, Émile Goudeau, qu’à la tolérance des autorités et à la simplicité d’adhésion : il suffisait de se prétendre poète, musicien, comédien ou artiste en tout genre pour y être accepté.

Georges Lorin, dit Cabriol (1850-1927)
Caricature de Sarah Bernhardt
L'Hydropathe, no 6 du 5 avril 1879
Sarah Bernhardt y fit une apparition, Alphonse Allais y brilla de son humour absurde, et le rire devint un spectacle public. Une bohème en représentation, sans manifeste ni contrainte.
Mais comme toute utopie sans rigidité, elle s’évapora vite. Et sa dissolution en 1880 donna naissance à des héritiers plus subversifs encore. Contrairement au Parnasse ou au futur symbolisme, les Hydropathes ne prônent aucune doctrine. "Nous n'étions pas une école, mais la négation même des écoles", écrira Goudeau. Leur unité ? Un rejet commun de l'académisme et de l'ordre moral, un amour du vin et des jeux de mots, et cette conviction qu'en ces années de IIIe République balbutiante, la littérature doit descendre dans la rue.
Dissolution séminale
En 1880, après deux ans d'existence, Goudeau dissout officiellement le groupe - trop de chahut, trop de succès peut-être. Mais l'esprit hydropathe survit : la plupart des membres se retrouvent au Chat Noir de Rodolphe Salis, fondé en 1881. D'autres essaiment vers les Arts Incohérents de Jules Lévy ou le cercle des Hirsutes. Quant à la revue, elle cède la place à Tout-Paris, éphémère comme son nom l'indique.
Leur héritage est paradoxal. Oubliés pendant des décennies, redécouverts dans les années 1960 par les pataphysiciens, les Hydropathes apparaissent aujourd'hui comme les précurseurs de toutes les avant-gardes. Leur mélange de poésie et de spectacle annonce Dada, leur goût du canular préfigure les surréalistes, leurs soirées bruyantes anticipent les happenings des années 1960.
Les Hydropathes n'ont duré que deux ans. Mais en inventant la poésie-performance, en mêlant littérature et vie de café, en faisant du rire une arme contre l'académisme, ils ont ouvert la voie à tout ce qui viendra après. Leur vrai manifeste ? Peut-être ces mots de Goudeau : "Nous étions jeunes, nous avions soif de tout - surtout de vin et de liberté." Un programme qui n'a pas pris une ride.
Enfumés
Le Fumisme, c’est d’abord une grimace adressée au sérieux, un rire jaune lancé au visage d’un monde compassé. Dans le Paris désenchanté de la fin du XIXe siècle, cette nébuleuse sans manifeste clair, sans drapeau ni quartier général, trace pourtant l’un des traits les plus incisifs de la contre-culture moderne. À qui demande ce qu’est le Fumisme, Alphonse Allais, son chef autoproclamé, répond d’un haussement d’épaules et d’un aphorisme : « La vie est une fumisterie, et l’art en est la plus belle blague. » Tout est dit — ou plutôt, tout est désavoué.
L’expression surgit en 1878, lors d’une soirée trop arrosée entre Hydropathes. Émile Goudeau, leur fondateur, lance dans un éclat de voix : « Nous sommes des hydropathes… mais surtout des fumistes ! » La blague fait mouche. Le mot claque, plein de fumée et de moquerie, dérivé de ce verbe populaire qui signifie "tromper", "baratiner", "foutre de la poudre aux yeux". Le Fumisme, c’est l’art d’enfumer le bourgeois, de faire mine de penser sans rien penser du tout, comme le dira Arthur Sapeck, caricaturiste en blouse blanche, qui s’en fera le prophète hilare.

Eugène François Bonaventure Bataille, dit Arthur Sapeck (1853-1891)
La Joconde fumant la Pipe
Illustration pour Le Rire de Coquelin Cadet, 1887
Leur méthode ? Un ridicule assumé, une moquerie sans frontières visant la bêtise ambiante et la bonne conscience bourgeoise. Plus la confusion était grande, plus la performance était réussie. Ce qui commença comme une plaisanterie d’Hydropathes déçus devint une philosophie : tout n’est que fumée. Et le mot lui-même, en français, se prêtait à toutes les dérives : de la vapeur du tabac aux menteurs, des bavards aux fumiers.

Alphonse Allais (1854-1905)
Marche Funèbre composée pour les funérailles d’un Grand Sourd
1883
Imbitable
Ce qu’ils visent ? L’intelligibilité même. « Plus c’est incompréhensible, plus c’est réussi », lâchent-ils avec jubilation. Là où les Hydropathes s’encanaillaient dans les cafés en récitant des vers, les Fumistes, eux, dynamitent la scène, l’image, le texte, la partition : tout ce qui peut prétendre être de l’art. Allais compose une marche funèbre muette, dédiée à un grand homme sourd : une partition sans une seule note. Sapeck organise des expositions de tableaux invisibles. La presse devient pour eux un terrain de jeu illimité. Allais s’en donne à cœur joie, inondant les journaux de fausses nouvelles : l’une des plus célèbres raconte la découverte d’un cimetière d’éléphants sous l’Opéra de Paris. Sapeck, lui, va plus loin encore : il lance Le Fumiste Illustré, un journal intégralement blanc, sans texte, sans image. C’est la page vide comme bras d’honneur à la presse sérieuse.
Si Arthur Sapeck, caricaturiste et maître mystificateur, en fut le théoricien malgré lui, Alphonse Allais en incarna l’esprit, avant qu’Erik Satie n’en reprenne le flambeau, faisant le pont entre Fumisme et dadaïsme naissant.
Le Fumisme ne s’arrête pas aux frontières de Montmartre. Il déteint, il contamine, il préfigure. Erik Satie, dans Parade, se proclamera « fumiste qui s’ignore » : musique en klaxon, bruitages de machine à écrire, danse déglinguée — l’esprit est là, intact. En Russie, Mikhaïl Savoyarov reprend le flambeau sous un autre nom, le Fonforisme Enfumé, et sème la zizanie poétique à Saint-Pétersbourg. Plus tard, les Dadaïstes, Tzara en tête, reconnaîtront en Sapeck un précurseur. Breton lui-même saluera en Allais un maître du non-sens, « seul humoriste à ne pas faire de l’humour ».
Mais pourquoi ce goût pour le néant rigolard, ce culte de la blague absconse ? C’est que le Paris de la Troisième République est un monde traumatisé, verrouillé par l’ordre moral et les commémorations creuses. Le Fumisme propose une échappatoire : tout tourner en dérision, surtout l’art, surtout les institutions, surtout soi-même. Sous le masque du bouffon, une critique radicale se glisse : à quoi bon la grandeur, à quoi bon les prix de Rome, quand le monde se relève à peine de la boucherie de la Commune ? Le rire devient une arme politique. Ils raillent l’académisme, sabotent la solennité, répondent à l’autorité par la farce : « Un prix de Rome ? Donnez-le à un aveugle ! »
Au Chat Noir, laboratoire nocturne de cette dérision méthodique, un nouveau genre se développe : le monologue Fumiste. Charles Cros y excelle. Il déclame Le Hareng saur avec le ton professoral d’un conférencier académique, et déclenche des tempêtes de rires. C’est l’art de dire des bêtises avec gravité, résume-t-il, tout en faisant vaciller la frontière entre le sens et la bêtise.
Et comme souvent avec les avant-gardes, leur insoumission est vite recyclée. Le Chat Noir, tout en hébergeant les Fumistes, commence à vendre leur irrévérence emballée façon cabaret. La bourgeoisie, qui rit de bon cœur à ces subversions mises en scène, finit par les intégrer. Rien de plus Fumiste, finalement, que de transformer la révolte en carte postale juteuse.
Arthur Sapeck saboteur

anonyme
Eugène François Bonaventure Bataille, dit Arthur Sapeck (1854-1891)
date inconnue
C’est l’un des visages les plus insolents du Paris fin-de-siècle, et pourtant son nom reste dans l’ombre. Derrière son pseudonyme provocateur : Sapeck, abréviation de "ça pue", se cache un peintre raté devenu maître mystificateur, prince du canular visuel et incarnation la plus radicale du Fumisme. Si Alphonse Allais en fut le théoricien goguenard, Sapeck en fut l’activiste masqué, saboteur en chef d’un monde trop plein de sérieux.
Formé aux Beaux-Arts, où il s’ennuie ferme, Sapeck comprend la peinture officielle comme un théâtre d’illusions et choisit d’en faire une parodie. Sa cible : l’autorité de l’art, de l’État, et de la pensée elle-même. Il ne peint pas pour éblouir, mais pour démystifier, pour exhiber l’absurde derrière le vernis. Sa célèbre Joconde fumant la Pipe est un attentat joyeux contre le culte de l’œuvre. Il aurait pu se contenter d’un pastiche : il choisit un blasphème.

Eugène François Bonaventure Bataille, dit Arthur Sapeck (1854-1891)
Calendrier anti-Clérical pour 1882
Et il récidive : faux Rembrandt à la sauce tomate, paysages invisibles, expositions vides, portraits retournés… tout est bon pour enfumer l’institution.
Sapeck ne se contente pas de peindre : il se met en scène. Il se promène dans Paris grimé en Pierrot, le visage intégralement couvert de peinture blanche. Il rédige des manifestes à la frontière du non-sens, fait publier des revues fictives (Le Fumiste Illustré, parfois réduite à une seule page blanche), multiplie les pseudonymes pour se signer lui-même comme une œuvre garantie instable. Loin d’un simple amuseur, il incarne une position esthétique : l’artiste comme perturbateur professionnel, dont le rôle n’est pas de construire, mais d’enrayer la machine.
Autour de lui gravite une constellation de marginaux magnifiques : Alphonse Allais, Charles Cros, Coquelin Cadet, et bientôt Alfred Jarry. Tous partagent un même mépris pour le sérieux, un goût immodéré pour le canular, une défiance frontale envers les institutions culturelles. Mais Sapeck pousse plus loin : il ne veut pas faire rire, il veut faire vaciller. Son humour est acide, son absurdité corrosive. Il n’invite pas à la rêverie, mais à l’inconfort joyeux. Comme il l’écrit lui-même, le Fumisme, c’est l’art de faire croire qu’on pense quand on ne pense rien, et donc de démonter tous les simulacres de profondeur que la société érige comme totems.
Sapeck meurt jeune, à 36 ans, sans postérité institutionnelle, sans disciples revendiqués. Sapeck reste l’un des grands fantômes de la modernité : out le monde « sait » sa Joconde et elle transparaîtra dans quantité d’œuvres postérieures. De Sapeck il reste un artiste sans œuvre au sens classique, mais avec un geste : celui de l’ironie absolue, de la dérision comme langage, de l’absurde comme contre-pouvoir. Il n’a pas cherché la postérité : il a préféré rire d’elle. Et c’est peut-être ce qui fait de lui l’un des artistes les plus lucides de son temps.
Sapeck, c’est l’artiste qui rit au lieu de créer, qui gribouille au lieu de composer, qui signe un pastiche en place d’une œuvre, et qui par là même interroge ce qu’est vraiment un artiste.
Et une œuvre.
Alphonse Allais : fumer l’art à la blague

anonyme
portrait d’Alphonse Allais (1854-1905)
vers 1900
Né en 1854 à Honfleur, Alphonse Allais aurait pu devenir pharmacien comme son père. Il en a gardé un goût certain pour les mélanges douteux, les poudres d’escampette et les formules fumantes – mais dans les pages de journaux, sur les scènes de cabarets ou dans les salons où l’on riait à s’en faire péter la rate. Son domaine n’était pas la médecine, mais la mystification. Et parmi les Fumistes il fut plus qu’un complice : un chef de bande officieux, artisan d’un art qui n’avait d’autre finalité que de se payer la tête de celui qui lui en cherchait une.
Allais, c’est l’ironie faite homme. Il pratique le canular comme d’autres la peinture de chevalet. Il publie de fausses nouvelles dans les journaux (le cimetière d’éléphants découvert sous l’Opéra de Paris), invente des brevets absurdes (des boulettes explosives pour faire sauter les moustiques), signe des poèmes qui s’achèvent en queue de poisson, et surtout : il théorise la vacuité comme une esthétique et publie un recueil de Peintures primo-avrilesques, dont Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige qui réussit l’exploit de ridiculiser ce qui n’a pas encore été inventé.

Alphonse Allais (1854-1905)
Première communion de Jeunes Filles Chlorotiques par un Temps de Neige
1897
Dans le sillage de Sapeck, son frère en canulars, il contribue à faire du Fumisme un anti-discours. Là où les Hydropathes avaient structuré une bohème conviviale, Allais injecte du venin, du chaos et un rire désespéré. Il écrit, dans un de ses aphorismes les plus célèbres, que « l’art est la plus belle des blagues ». Pas un rejet cynique, mais une revanche du rire sur les prétentions des salons et des académies. Dans le cabaret du Chat Noir, où il est une figure centrale, il compose des chansons très scientifiques, des monologues absurdes, des notices pseudo-sérieuses : autant de grains de sable dans la mécanique du bon goût comme du goût le plus douteux.
Allais n’a pas besoin de fonder un « mouvement » : il est lui-même un centre de gravité. Ceux qu’on appellera plus tard les dadaïstes, les surréalistes ou les situationnistes puiseront à sa source sans toujours le savoir. Il incarne ce moment-clé où la satire devient une esthétique, où la parodie devient une position politique, et où l’humour se transforme en désobéissance. On pourrait dire qu’il est le Voltaire des Fumistes, sauf que Voltaire croyait encore à quelque chose. Allais, lui, ne croit pas : il fait croire. Et il rit pendant que les autres se prennent au sérieux.
Il meurt en 1905, sans avoir jamais cessé de publier, de rire et de faire rire. Sa trace est tenace. On la retrouve chez Erik Satie, son ami silencieux, dans les récits abracadabrants de de Raymond Roussel, dans les ready-mades de Marcel Duchamp, ou encore chez les clowns cruels de Pierre Dac. Il est l’un des très rares écrivains français à avoir fondé une tradition de l’humour intelligent, qui ne soit ni boulevardier, ni potache : un humour qui mord, qui dérange, qui retourne les valeurs à la manière d’un gant noir tiré d’une main blanche.
Alfred Jarry passé à l’acide

Atelier Nadar
portrait d’Alfred Jarry (1873-1907)
1896
Si les Fumistes avaient besoin d’un enfant terrible, Alfred Jarry l’a été : non pas par fidélité, mais par excès. Trop jeune pour appartenir aux Hydropathes, trop farouche pour se laisser enfermer dans un cabaret, il hérite du Fumisme en le poussant dans ses retranchements. À la rigolade potache, il substitue une folie méthodique. À la mystification légère, il oppose une violence symbolique. Le rire, chez lui, n’est plus un jeu social : c’est une arme de guerre.
Né en 1873, Jarry grandit dans l’ombre d’Allais, de Sapeck, et des autres barons de l’absurde. Il les lit, les admire, les transgresse. Lorsqu’il publie Ubu Roi à vingt-trois ans, en 1896, ce n’est pas une simple provocation : c’est une insurrection théâtrale. Le père Ubu est un concentré de bêtise autoritaire, de lâcheté grotesque, de brutalité administrative — un avatar démesuré de tous les notables ridiculisés par les Fumistes deux décennies plus tôt. Mais Jarry n’en fait pas une caricature : il en fait un mythe.

Programme pour Ubu Roi, d’Alfred Jarry
1896
Minneapolis Institute of Art
Dans le droit fil des Fumistes, Jarry pratique le sabotage du langage. Il invente des mots, pulvérise la syntaxe, insulte la logique. Mais là où Allais utilisait le calembour comme esquive, Jarry s’en sert comme scalpel. La pataphysique, sa science des solutions imaginaires, est une extension terminale du Fumisme : un système de pensée qui ne pense à rien, un savoir ironique sur un monde vide de sens. C’est l’art de faire croire qu’on pense quand on ne pense rien, disait déjà Sapeck. Chez Jarry, c’est devenu une religion.
Mais ce qui rattache Jarry aux Fumistes, c’est sa pratique : vivre sa propre légende, refuser toute frontière entre art et existence. Il parle par aphorismes, roule à vélo comme un centaure moderne, conserve un pistolet chargé sur sa table de chevet. Son mode de vie est une performance continue. Il ne joue pas au poète maudit, il est le poète démantelé, l’Ubu de lui-même. L’humour, chez lui, devient un ascétisme. Le grotesque, une mystique.
Jarry ne fréquente pas les Fumistes de Montmartre, mais leur ombre plane dans chacun de ses gestes. Comme eux, il attaque les institutions, la morale, la bienséance, l’art officiel. Comme eux, il se méfie du sérieux comme de la peste. Mais là où Sapeck peignait en dérision, Jarry écrit en transe. C’est le moment où le Fumisme quitte les coulisses du cabaret pour entrer dans la littérature.
Mort à trente-quatre ans, tuberculeux, alcoolique, presque oublié de son vivant, Jarry lègue aux modernes une posture : celle de l’artiste inassignable, imprévisible, rigoureusement absurde. Ses héritiers s’appellent Antonin Artaud, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, mais aussi Marcel Duchamp, Jean Dubuffet ou Boris Vian. Et tous passent par ce détour étrange qu’est le Fumisme : cette zone d’ombre joyeuse où l’humour devient vision, et où la blague, en grinçant, fait tomber le masque du monde.
Arts Inc.
Pendant plus de dix ans (1882-1895), cette bande d'artistes, écrivains et humoristes conduits autour de Jules Lévy multiplie les expositions subversives : parodies d'œuvres célèbres, satires politiques, jeux de mots visuels, détournements d'objets. Le public, ravi, se presse en masse, séduit par ce cocktail de provocation et d'humour qui fait office d'exutoire dans une fin de siècle troublée.

Affiche de l’exposition des Arts Incohérents à l’Olympia
1893
Le noir soulage
Paris, 1882. Dans un atelier de la rue Antoine-Dubois, une vingtaine d’invités s’esclaffent devant un tableau noir encadré comme si c’était un Rembrandt. Son titre ? Combat de nègres dans une cave pendant la nuit. Son auteur, Paul Bilhaud, poète et non peintre, vient d’inventer le monochrome moderne avant même qu’il n’existe.
Et en noir, qui plus est.

Paul Bilhaud (1854-1933)
Combat de nègres dans une cave pendant la nuit
peinture à l'huile sur toile, 1882
Dans leurs salons déjantés, tout est permis à condition d'être délibérément ridicule. Tableaux exécutés par des analphabètes du dessin, monochromes absurdes, calembours visuels... Un anti-art qui tire la langue aux musées tout en squattant leurs vitrines. On y retrouve l'esprit Zutique, mais poussé à l'extrême permis par le calembour le plus misérable. Le Sonnet de Rimbaud et Verlaine avait tout de même conservé quelques apparences de la poésie...
Comment représenter "un ministre ayant l'oreille du gouvernement" ou "un criminel étouffant la voix de sa conscience" ? Tels sont les défis que relèvent les Incohérents en défendant mordicus le pied de la lettre : s’en tenir au premier degré c’est assurer l’accès simultaané à tous les autres. Leur credo ? l'art comme divertissement public, où le sérieux est l'ennemi à abattre.
L'art des amateurs
Jules Lévy mise délibérément sur des créateurs "qui ne savent pas dessiner", recrutant parmi ses amis du Chat noir ou des Hydropathes. Baudelaire y sera exposé à titre posthume en 1883. La première exposition officielle à la galerie Vivienne en octobre 1883 accueille 20 000 visiteurs en un mois, quantité d’amateurs sont attirés par son règlement iconoclaste : "Toutes les œuvres sont admises, les œuvres sérieuses et obscènes exceptées." . Ce qui attire tous ces dessinateurs et caricaturistes en herbe, c’est évidemment la promesse d’un petit quart d’heure de célébrité.

exposition des Arts Incohérents
galerie Vivienne, Paris, octobre 1883
Leurs expositions, organisées entre 1882 et 1893, sont des happenings avant l’heure. On y trouve des « œuvres follement hybrides » de Félix Fénéon, des rébus visuels, des calembours sculptés (Un ministre ayant l’oreille du gouvernement), ou encore des monochroïdes comme le célèbre Récolte de tomates sur le bord de la Mer Rouge par des cardinaux apoplectiques.
Simples farceurs
Pourtant, ces farceurs ne se prenaient pas pour des révolutionnaires. L’Incohérence est une gaieté, pas une école, clame Jules Lévy. Leurs expositions itinérantes (Rouen, Lille, Nancy) mêlent artistes locaux et parisiens dans une joyeuse anarchie. À Rouen, en 1883, ils répondent aux critiques réactionnaires comme Alfred Darcel qui qualifiait leurs œuvres de «vilains arts», par des rébus satiriques. Leur bal costumé de 1885 était orné de panneaux « Prière de ne pas cracher au plafond ».

Jules Chéret (1836-1932)
affiche pour l’Exposition des Arts Incohérents 18 octobre – 19 décembre 1886
L'essoufflement
Après 1886, le mouvement s'épuise. Lévy, critiqué pour son entreprise éditoriale jugée trop commerciale, proclame la fin de l'Incohérence en 1887 lors d'un ultime bal. Pourtant, leur esprit de dérision systématique et leur remise en cause des valeurs établies restent étonnamment modernes.
Les Incohérents n’étaient pas des artistes. Ou plutôt, ils étaient des artistes malgré eux : des poètes, des journalistes, des cabaretiers qui ont retourné l’art comme un gant, révélant son envers grotesque. Leur histoire rappelle que des révolutions peuvent naître d’une plaisanterie. Et que le chef-d’œuvre peut-être aussi celui qui refuse de se prendre au sérieux.
En fusionnant humour et art, les Incohérents ont créé un modèle précurseur des avant-gardes du XXe siècle, en soutenant qu'une grimace bien tournée peut parfois valoir tous les manifestes.
Chat !
Le Chat Noir. Un nom qui, aujourd’hui encore, semble surgir d’une enseigne de Willette ou d’une affiche de Steinlen : noir sur fond de lune. Le Chat Noir n’est pas seulement un cabaret : c’est une invention. Un concept hybride, métisse, charbonneux, monté sur les ruines des rêves de la Commune et troublé par les effluves de l’absinthe. Le Chat Noir c’est l’idée d’un poète charlatan devenu un entrepreneur renommé : Rodolphe Salis, fils de limonadier et faux gentilhomme, qui décida en 1881 qu’il fallait marier le vers, la piquette et la Fumisterie, dans un lieu où les bourgeois paieraient pour être moqués.

Adolphe Léon Willette (1857-1926)
enseigne pour le cabaret du Chat Noir (réactualisation)
Musée Carnavalet, Paris, Inv. EN192
Le premier Chat Noir, ouvert au numéro 18 du boulevard Rochechouart, tenait davantage de la cave que du palais. On y entrait en franchissant un seuil gardé par un Suisse chamarré comme un archevêque de carnaval, chargé de refouler les militaires, les curés et les importuns. Là, dans une lumière pauvre et un décor sommaire, on servait du mauvais vin en adressant des blagues bien troussées. C’est dans ce capharnaüm que Salis accueillit Émile Goudeau et son club des Hydropathes, transfuges de la rive gauche, qui remplirent la petite salle se remplit de vers, de chansons, d’invectives, de déclamations et de cris. L’audience venait y chercher le frisson que procure un mot bien envoyé, par un poète inspiré ou entendre une insulte bien sentie que l’on pourrait rapporter ensuite. On y raillait les puissants, on y déclamait l’égalité, on y chantait la misère puisqu’on la connaissait assez bien.

Anonyme
Le Cabaret du Chat Noir
18, boulevard de Rochechouart, Paris
1881
Salis lui-même faisait le tour des tables, goguenard et mordant, fustigeant les cocus, les femmes légitimes, les têtes couronnées. Il s’était forgé une silhouette : barbe rousse, verbe haut, costume improbable de seigneur montmartrois. Son sens de la mise en scène n’avait d'égal que sa pingrerie ; on disait qu’il était plus prompt à dérober les parapluies qu’à régler les cachets de ses artistes. Qu’importe : autour de lui gravitait une constellation de talents que peu d’établissements pouvaient revendiquer.

Anonyme
Le Cabaret du Chat Noir 12, rue Victor Massé
1885
Salis, flairant le succès, décida de voir plus grand. En 1885, il déménagea l’établissement au 12, rue de Laval, dans un ancien hôtel particulier du peintre Alfred Stevens. Il le transforma en un décor baroque, foutraque et flamboyant : vitraux de Willette, fresques de Steinlen, théâtres d’ombres d’Henri Rivère, affiches, lanternes médiévales de Grasset, chats en terre cuite sur des blasons en soleil. Le Chat Noir devenait l’Hostellerie du Monseigneur Salis, seigneur de Chatnoirville-en-Vexin. Et tout Paris y défilait.

Paul Merwart (1855-1902)
L’Épopée
première projection d’ombres au Cabaret du Chat Noir
d’après un dessin de Caran d’Ache
gravure, 1886 Musée Carnavalet, Paris, Inv. 09-517475
personnalités citées : Alphonse Daudet, Émile Zola, Ferdinand de Lesseps, le Général Boulanger Coquelin Cadet et Carolus-Duran
Mais le ver était dans le fruit. Le succès attirait le Tout-Paris, les snobs, les poseurs. La jeunesse anarchiste et les poètes libertaires préféraient les petites salles enfumées du bas Montmartre. Le cabaret de Salis devenait une vitrine plus qu’un creuset. Qu’importe, Salis persistait. Il déménagea encore, au 68, boulevard de Clichy, où il eut beau installer une enseigne du chat noir sur sa lune argentée, l’esprit de la première heure était mort.

Anonyme
Une Soirée au Chat Noir, 68 boulevard de Clichy
ca. 1886
Une revue
Le Chat Noir n’était pas qu’un cabaret. C’était aussi une revue. Créée en 1882, le journal Le Chat Noir, dirigé d’abord par Goudeau puis par Alphonse Allais, fut une entreprise aussi mordante qu’iconoclaste. 688 numéros furent publiés jusqu’en 1895, puis 122 autres jusqu’en 1897.

L e Chat Noir n°8, 13 mai 1882
On y trouvera des signatures aujourd’hui historiques parmi lesquelles : Paul Verlaine, Jean Lorrain, Jean Richepin ou Marcel Schwob. On y lisait des canulars, de fausses morts, des parodies à froid, des critiques en vers et des nouvelles au vitriol. Le journal a pu annoncer la mort de Salis lui-même, pour le plus grand délice de ses fidèles. Cette revue fut l’un des grands laboratoires de la satire illustrée, où s’épanouirent quantité de dessinateurs satiriques et populaires, ce qui invite à situer le Chat Noir comme une articulation entre le journal satirique du XIXe siècle et la bande dessinée du XXe.
Lorsque Salis meurt en 1897, le Chat Noir est déjà un mythe. Le lieu lui survit quelque temps : repris par Henri Dreyfus, il devient La Boîte à Fursy. Mais déjà, le cœur bat ailleurs. Aristide Bruant, qui fut l’un des piliers du premier Chat Noir, crée Le Mirliton dans les anciens locaux de Salis. Lui aussi avait commencé dans la misère, enfant de bourgeois ruinés, bâtard de la zone et des faubourgs. Il avait tout appris sur le tas : les filles, les voyous, l’argot. Passé par les goguettes et les concerts populaires, il était devenu une vedette. Sa réputation était faite quand Jules Jouy l’entraîna un soir de 1881 au Chat Noir. Il y forgea un nouveau personnage : bottes, chemise rouge, manteau de velours, langue verte, et répertoire réaliste.
Au Mirliton, Bruant prolongea l’esprit du Chat Noir, avec plus de radicalité politique, plus de violence dans les mots. Il y chantait la zone, les bordels, les prisons, les faubourgs. Il dédaignait les salons. Il était devenu le chantre de ceux qui n’avaient pas voix au chapitre. Et quand le Chat Noir s’éteignit, c’est chez Bruant que les derniers feux de la bohème montmartroise brillèrent encore un temps.

Théophile Alexandre Steinlein (1859-1923)
Tournée du Chat noir de Rodolphe Salis
affiche, lithographie en couleurs, 1896
L’affiche dessinée par Alexandre Steinlen en 1896, Tournée du Chat Noir, scelle la postérité du cabaret. Son chat noir profilé sur fond lunaire devint une icône, reproduite à l’infini. Elle contribua à établir le mythe d’un lieu fantasque, où les artistes étaient rois et les bourgeois les dindons de la farce. Cette image a fait florès dans le monde entier. De Dunkerque à Tokyo, des cabarets nommés Chat Noir ont fleuri, sans toujours bien saisir ce qu’ils reproduisaient.
Paris – Munich
Mais le modèle, le vrai, celui qui allait reprendre le flambeau en le tordant à sa manière, était allemand. En 1896, l’année de la mort de Salis, paraît à Munich un hebdomadaire satirique qui allait devenir la grande tribune de la contre-culture germanique : Simplicissimus. Cabaret graphique, organe mordant, politique, illustré de caricatures aussi féroces que raffinées, Simplicissimus incarne pour l’Allemagne ce que furent Le Chat Noir et sa revue pour la France : un sanctuaire de l’insolence où les mots et les images, liés comme dans une chanson de Rollinat, mettaient le feu à l’époque.
Le Chat Noir, en somme, n’est pas un lieu. C’est la métaphore joyeuse et anarchisante de la résistance par le rire, l’art, l’outrance, c’est l’érudit canular et la gouaille en vers. C’est un souffle qui aura inspiré des journaux, des cabarets, des esprits, bien au-delà de la butte Montmartre. Le Chat Noir ne dort pas.
Il guette encore.
Fini de rire
la nébuleuse alternative, 1880-1900
la fronde incarnée par les Hydropathes et le Chat noir reste, pour l’essentiel, urbaine, ironique, théâtralisée. Elle ne franchit pas vraiment les limites du cadre. C’est un jeu dangereux, mais ça demeure un jeu. À la fin des années 1880, une ligne de rupture se dessine. Depuis Montmartre et ses cabarets, on descend vers Belleville, Ménilmontant, Charenton, Joinville, vers les bords de Marne et les forêts encore proches. On abandonne le sarcasme pour l’attaque directe, le pamphlet, la propagande, voire : le sabotage. Autour du cabaret se forme une nébuleuse mêlant individualisme anarchiste, naturisme naissant, antimilitarisme actif et rejet total de la société bourgeoise. C’est elle qui affleure dans les pages de revues comme L’Endehors, dans les procès retentissants des années 1890, dans les vies en rupture de Zo d’Axa ou de Félix Fénéon.

bombardement du du Restaurant Very
sur le Boulevard de Magenta
en représailles à l'arrestation de Ravachol, 25 avril 1892
lithographie
Zo d’Axa, voilà bien un pivot. Un drôle d’homme, tout en élégance nerveuse, qui ne voulait pas être un chef mais fascinait par sa rage lucide. Il avait tout refusé : l’armée, le travail, la presse conformiste. Son journal L’Endehors, fondé en 1891, est un volcan sous la République. Il y invite les marginaux, les naturistes, les anticléricaux, les nihilistes, les vagabonds, les femmes libres, les amoureux des bêtes et de la forêt. Il y donne la parole à ceux qu’on fait taire, ceux qu’on enferme.
Ce n’est plus un journal, c’est un refuge.

L ’Endehors n°32, du 13 décembre 1891
Mais ce refuge n’a rien d’un sanctuaire : l’époque est celle des premiers coups d’éclat de l’action directe. Si L’Endehors et Zo d’Axa professent une non-violence de principe, ils s’inscrivent néanmoins dans une famille politique qui a rompu avec toute foi dans les institutions, les lois ou les procédures républicaines, et qui, pour une part croissante, se prépare à l’affrontement armé. Le climat est lourd : en 1894, le président Sadi Carnot est assassiné par l’anarchiste Caserio, dans la foulée d’une série d’attentats liés à Ravachol. Le mot « nihiliste » devient synonyme d’anarchiste poseur de bombes ; les plans circulent, les explosifs aussi. Dans ce contexte, la position de L’Endehors est instable, presque intenable : d’un côté, la revue fournit aux autorités une précieuse cartographie de la mouvance libertaire ; de l’autre, elle sert de caisse de résonance à des idées frappées d’illégalité par les actes qu’elles inspirent. C’est un entre-deux périlleux, un seuil où la parole critique se prononce au risque de l’inculpation.

Henri Thiriat (1843-1926)
La rédaction de l’Endehors
image publiée dans L’Illustration du 10 février 1894
de gauche à droite : Zo d’Axa, Tabarant, A. Hamon
en arrière : Jean Grave, Octave Mirbeau et Bernard Lazare
devant : Charles Malato et un inconnu.
Zo écrit comme il vit : à l’encre noire. Contre les patrons, contre les curés, contre les juges, contre les conscrits. Il défend Ravachol, il glorifie les forçats, il admire les fous. Il écrit :
Les honnêtes gens me dégoûtent. L’ordre m’ennuie. Je suis un hors-la-loi, mais pas un criminel. L’État, lui, l’est.

Maximilien Luce (1858-1941)
illustration pour La Feuille, vers 1897
D’Axa organise des fêtes naturistes, fréquente les colonies libertaires, rêve d’un monde sans frontières ni vêtements. En 1893, poursuivi pour « provocation au meurtre » et « outrage à la morale publique », il se fait arrêter, s’évade, vit en clandestin. Il parcourt l’Italie, la Suisse, la Belgique, se réfugie en Angleterre, rencontre Maximilien Luce, Camille Pissarro et James Abott McNeill Whistler, revient pour être jugé, refuse de se défendre, parle de théâtre judiciaire.
Et sort libre.
Sa pensée tient dans une exigence : vivre en dehors (en dehors du salariat, de la famille, de la nation, du devoir). Il prône le refus, l’errance, l’amour libre, la vie nue. Il annonce ce que les communautés végétariennes, naturistes, néo-païennes des années 1900-1910 tenteront de mettre en œuvre : un monde sans propriété, sans hiérarchie, sans dieu ni uniforme.
Son Album de l’Endehors, illustré par Luce, Steinlen, Willette, est une des grandes œuvres visuelles du refus. Dans ces pages, les juges ont des gueules de chiens, les prisons des airs d’abattoirs, les femmes des corps libres, les enfants des regards révoltés. Tout y est rage et beauté.
À ses côtés, Félix Fénéon, bien plus secret, mais tout aussi corrosif. Fonctionnaire au ministère de la Guerre le jour, conspirateur littéraire et anarchiste la nuit. Il est l’éditeur génial, l’esthète incorruptible, celui qui introduira Seurat, défendra Lautréamont, se passionnera pour les arts africains et les jeunes symbolistes.
Fénéon écrit peu, mais avec une acuité de scalpel. Ses Nouvelles en trois lignes, publiées en 1906 dans Le Matin, sont déjà un modèle de prose sèche, ironique, subversive. Mais avant cela, dans les années 1890, il est dans tous les coups : discrets ou explosifs. Il est soupçonné d’avoir fourni la poudre pour un attentat à la bombe. En 1894, il est arrêté lors des procès contre les anarchistes.
À la barre, il se moque des juges, calme, narquois, précis. Il est acquitté. Mais sa réputation est faite : le lettré aux allures de conspirateur, le dandy de l’ombre. Il est un chaînon essentiel entre les mondes. Il fréquente les cafés anarchistes, mais aussi les galeries. Il publie des poètes maudits, écrit des critiques d’art qui annoncent le XXe siècle.
Avec lui, c’est toute une génération qui passe par les interstices : ni ouvriers ni bourgeois, ni poètes ni militants, mais un peu tout cela à la fois. Des figures comme Georges Darien, libertaire au vitriol ; Louise Michel, la pasionaria de la Commune toujours active ; Séverine, journaliste sociale et anticoloniale ; ou encore Henri Zisly, nudiste intégral, précurseur du Lebensreform, fondateur de La Nouvelle Humanité.

Auguste Renoir (1841-1919)
Caroline Rémy – Séverine
pastel sur papier, 62 x 50 cm, 1885
National Gallery of Art, Washington, Inv. 1963.10.208

H enri Daudet (?-?)
Vue du Maquis de Montmartre prise depuis Caulaincourt juin 1887
BnF, Inv. PET FOL-VE-82 (E)
Naturiens
En 1894, alors qu'un militantisme naturiste libertaire gagne du terrain en Europe, un petit groupe d'anarchistes : Les Naturiens, s’implante à Montmartre, porteur une critique virulente contre le machinisme et l'industrialisme. Majoritairement issus du monde ouvrier précaire, les Naturiens puisent dans la philosophie de Rousseau et les découvertes des naturalistes de leur temps pour concevoir un projet de colonie libertaire, loin des villes polluées et malsaines où ils vivent. Le Montmartre encore verdoyant et plutôt insurgé, creuset d'un imaginaire politico-environnemental unique en marge du Paris haussmannien, les inspire profondément. Bien que marginalisés pour leur revendication de modes de vie primitifs, ils ambitionnent de politiser des enjeux souvent négligés par leurs pairs : l'artificialisation et la privatisation des sols, la déforestation ou les maladies industrielles, qu'ils s'efforcent d'intégrer au vocabulaire militant anarchiste.
Ces gens n’ont pas de parti. Ils ont des colères, des élans, des vies. Ce qu’ils ont en commun, c’est le refus du monde tel qu’il est, et l’expérimentation d’autres possibles. L’idée de « commune libre », de « tribu volontaire », de « société des égaux ». On retrouve ces pratiques dans les colonies de Aiglemont, de Vaux, dans les rencontres naturistes du bois de Vincennes ou de la Marne.

Anonyme
Fortuné Henry devant sa hutte d’Aiglemont en 1904
collection B. Coulaud
La nébuleuse alternative, entre 1885 et 1900, c’est ce moment de friction où les langues du refus (le rire, le pamphlet, le vers libre) s’ouvrent vers une mise en pratique qui puisse être une alternative au terrorisme : sortir du système, vivre autrement, non plus seulement rêver ou railler.
C’est là qu’apparaît la jonction avec le naturisme, le végétariannisme, la vie à l’air libre. On commence à parler de cuisines communautaires, de retour à la nature, de nudité intégrale, de refus du vêtement comme refus de l’ordre moral et industriel. Ce n’est pas encore Monte Verità, mais c’en est l’amorce.
On pourrait croire ces expérimentations sans lendemain, cantonnées à quelques esprits exaltés, à des arrière-cours de typographes idéalistes, à des ateliers où l’on rêvait nu sous les figuiers en pot. Et pourtant : la force de cette nébuleuse, c’est d’avoir rendu possible une autre manière d’habiter le monde, fût-ce à l’échelle de quelques corps, quelques repas, quelques gestes. Elle n’a pas triomphé car elle n’était pas faite pour. Mais elle a laissé des sillons invisibles dans la modernité : dans la pédagogie, dans les arts de vivre, dans l’écologie naissante, dans la critique sociale, dans l’idée même que le changement peut se faire par le bas, lentement, obstinément, à l’échelle des individus réfractaires.
Dans ces communautés fugitives, dans ces gestes de retrait, dans cette manière de penser à côté, il y a le ferment de ce que deviendront les Lebensreform, les nature boys, les communautés californiennes, les éco-villages, les hackers, les décroissants. Une histoire des marges, oui. Mais aussi une généalogie du refus.
Ce que la République ne saisit pas, c'est que cette dissidence ne relève pas d'un programme. Elle est une façon d'être – de marcher, de rire, d'aimer, de respirer. Une posture d'en-dehors. Le travail de sape du formalisme entrepris par les Fumistes a porté ses fruits : les alternatives qu'ils proposent échappent désormais aux codes du discours institutionnel. Elles s'en sont affranchies, au point de devenir incompréhensibles pour l'ordre établi, la morale bourgeoise, les académies et les chambres officielles. Au mieux, on y verra des enfantillages ; au pire, des lubies dangereuses. Et si nécessaire, il suffira d'un coup de matraque pour les disperser. Mais rien n’indique que cela suffise : l’évidence c’est que ces mouvements alternatifs échappent au pouvoir, à son ordre, et à son projet.
Tohu-Bohu
Et tout cela se passe entre les vannes du Chat Noir et les jambes de la Goulue.
Le cabaret s’efface, la danse commence. Le Moulin Rouge ouvre en 1889, la même année que la Tour Eiffel. Une manière de capter la lumière, de masquer l’insubordination. Mais ça ne suffit pas. Les idées circulent encore, par les tracts, les revues, les corps qui maintenant entrent en transe. On retrouve dans ces cercles parisiens les intentions d’ Eduard Baltzer, d’Adolf Just et d’Arnold Rikli : le souci du corps, du rythme, de l’alimentation, de la marche, de la respiration.
Le Mirliton
Il est des lieux qui incarnent une transition historique. Le Mirliton d'Aristide Bruant et le Moulin Rouge de Zidler et Oller sont de ceux-là : non seulement parce qu'ils cristallisent les tensions d'une époque (pendant qu’Aristide Bruant chante la misère au pied de Montmartre l’état construit une basilique à son sommet pour coiffer le souvenir de la Commune), mais surtout parce qu'ils abritent une mutation dans la manière d'habiter le corps sur scène et ce faisant : ouvrent à des possibilités inédites.
Loin d'être de simples distractions pour bourgeois en goguette, ces deux espaces, le Mirliton et le Moulin Rouge, constituent un pont entre la bohème littéraire du Chat Noir, les provocations de la chanson réaliste, la désinvolture du chahut montmartrois et l'émergence, plus à l'Est, d'une danse expressionniste qui fera vaciller le canon classique. Ce qui s'invente dans ces lieux n'est rien de moins qu'un usage inédit du corps pris comme manifeste. En poussant la porte du Mirliton, on s'engage sur un sentier qui mène directement au Moulin Rouge, et de là, à Mary Wigman.

Anonyme
Le Cabaret Bruant et le Théâtre du Trianon 84 boulevard de Rochechouart, Paris, 1885 carte postale
Flûte
En 1885, Aristide Bruant reprend un local abandonné par Rodolphe Salis pour en faire le Mirliton. Le choix du nom n'est pas anodin : il renvoie à un instrument de musique pauvre, grinçant, enfantin. Bruant, à rebours de Rodolphe Salis et de son snobisme décadent et lucratif, transforme la veine du cabaret en un art de la baffe. Bruant insulte le public, rit des dames bien mises venues de Passy, dévoile la misère en chanson et transforme la posture scénique en un cri de voyou. Son personnage est une synthèse : il est à la fois poète, chansonnier, mime et comédien de cour des miracles. Il n'imite pas la misère : il l’aboie à la gueule du monde. Son verbe est un corps, ses chansons une pantomime. Le public adore ça. Ce n'est plus du divertissement, c'est une expérience de transgression.
Mais Bruant n'invente pas ce langage seul. Il est l'héritier des Hydropathes, des Fumistes et des Incohérents, la bohème littéraire qui, depuis les années 1870, joue avec le grotesque, le désarticulé, l'absurde. Dans leurs spectacles, on mime des poèmes, on grimace, on parodie l'art noble, on met en scène une comédie de la marge, un rire de la laideur. Grille d'Égout, danseuse fantasque du Chat Noir, préfigure déjà par ses gestes débridés une liberté corporelle sans rigueur ni grâce. Le cabaret devient un théâtre des possibles où le ridicule n'est plus un risque, mais un outil : Ha !

Anonyme
Grille d’Égout, Danseuse
tirage photogrpahique sur papier albuminé, ca 1886
Musée Carnavalet, Paris, Inv. PH42858
Le Moulin Rouge
C'est dans cette filiation directe que s'inscrit le Moulin Rouge, inauguré en 1889 par Josep Oller et Charles Zidler, visionnaires de la fête moderne et animateurs du Carnaval de Paris. Montmartre, déjà réputé pour ses loyers bas et son air pur (130 mètres d’altitude, soit 100m plus haut que le Champ-de Mars) devient le laboratoire d'un brassage social et artistique où se croisent ouvriers, artistes, bourgeois et touristes. Le Moulin Rouge est un lieu d'éclat, désacralisé, délibérément carnavalesque. Le gigantesque éléphant en stuc, les affiches de Lautrec, la scène en perpétuel mouvement : tout y invite au délire et à la réversibilité des hiérarchies.
La Goulue, Grille d’Égoût et Jane Avril
Et puis il y a la Goulue.
Louise Weber, alias la Goulue, ne se contente pas de danser le cancan. Elle le transforme. Elle en fait un art de la provocation physique. Elle saute, expose ses dessous, lance sa jambe en l'air et brandit le pied à la face des convenances. Avec Valentin le Désossé, son comparse filiforme et dégingandé, et bientôt rejointe par Grille d’Égout, elle compose un trio grotesque et génial. Mais à elle seule, elle incarne ce moment de bascule où le corps féminin cesse d'être un objet érotique pour devenir un sujet de défi. Elle ne danse pas pour plaire, elle danse pour dominer, provoquer, faire rire et faire peur. Reine du bal, elle n’autorisera personne à toucher au titre, et prendra toute la lumière dont il serait juste de faire rejaillir quelques rayons sur Grille d’Égout et Jane Avril.

Danseur non identifié, La goulue, Grille d’Égout et Valentin le Désossé
tirage sur papier albuminé, ca 1891
Musée Carnavalet, Paris, Inv. PH2742
Cancanières
Le nom n’existe pas encore, mais sa gestuelle est déjà expressionniste. Elle est anti-académique, déformée, volontairement débraillée. Les figures du Cancan : le port d'armes, le saute-mouton, la mitraillette, sont autant de postures de guerre, de jeu, de libération. Et cette liberté formelle, sans code ni école, ouvre une brèche.
La Goulue n'est pas une ballerine, elle est une performeuse. Indifférente aux standards qui calibrent celui des soumises, elle fait de son corps un langage, à la manière des poètes qui faisaient du verbe une mandale. Elle incarne ce que Bruant chantait avec son insultante précision. Elle est le corps de la marge, le geste de l'insolence.
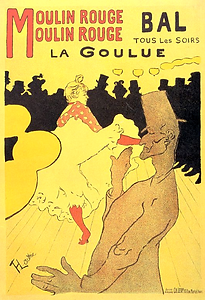
H enri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)
Moulin Rouge – La Goulue
lithographie en quatre couleurs, 191 x 171 cm, 1891
Metropolitan Museum of Art, Inv. 32.88.12
Toulouse-Lautrec, qui la peint encore et encore, comprend que quelque chose se passe ici qui dépasse le divertissement. Ses affiches ne documentent pas seulement un lieu : elles fixent sur le papier la fulgurance d'un corps en révolte.
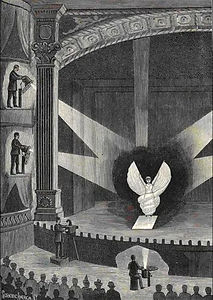
Loie Fuller (1862-1928)
installation scénique des projecteurs avec filtres polychromes
Scientific American, 1896
Loïe Fuller
En 1892, dans un autre espace du spectacle, celui des Folies-Bergère, Loïe Fuller invente la danse Serpentine. Fruit du hasard, née d'un costume trop large, cette chorégraphie devient un phénomène. Fuller, à l'opposé de la Goulue, ne montre pas son corps : elle le dématérialise. Elle devient une forme lumineuse, un volume en mouvement, une image vivante, fantastique. Elle ne danse pas : elle vole, et ce faisant, elle aussi rompt avec le ballet. Elle utilise la technologie : miroirs, baguettes, jeux de lumières colorées, pour transformer la scène en un tableau mouvant. L'Art nouveau reconnaît immédiatement en elle l'une de ses icônes : arabesques, lys, volutes, toutes les figures du décor deviennent ici volumes dansants. Mallarmé l'admire. Les frères Lumière la filment. Rodin la dessine. Fuller incarne une autre voie de la modernité : la dissolution du corps dans la sensation pure.
Si la Goulue incarne la chair, Fuller est l'éther. Percept contre concept. Mais toutes deux, à leur manière, détruisent les codes anciens de la danse. La première par la provocation, la seconde par l'abstraction. Et c'est à ce carrefour que se prépare la révolution de Mary Wigman.
Sorcière
Née dans l'Allemagne wilhelmienne, formée dans le sillage de Rudolf von Laban, Wigman ne connaît pas directement le cancan ni les cabarets montmartrois. Mais l'énergie qui anime sa danse, le refus du beau, la recherche d'un mouvement né du dedans, d'un spasme, d'une nécessité vitale, la relie directement à ces femmes qui, à Montmartre, ont fait du corps un opéra de bruits, de gestes et de cris. Sa "Danse de la Sorcière", créée en 1914, est une déflagration. Elle danse pieds nus, le visage déformé, dans des torsions qui rappellent les grimaces de Grille d'Égout ou les pas hachés de la Goulue. Elle ne cherche pas à s'élever : elle creuse dans le sol, dans l'inconscient, dans la douleur. Elle donne corps au malaise de son temps.

H ugo Erfurth (1874-1948)
Mary Wigman exécutant la Danse de la Sorcière
1926
Filiation
Le cabaret parisien, en déconstruisant les hiérarchies, en mêlant le grotesque au sublime, en faisant de la moquerie un moteur de création, a permis à la danse d'émerger comme langage autonome, à part entière. Le cancan n'est pas qu'une distraction. C'est un manifeste. Il nie la grâce aristocratique, il déchire les jupons, il tourne la jambe en arme. Il est à la danse ce que le Ubu Roi de Jarry est au théâtre : un bâton de dynamite posé au pied des conventions. Ce n'est pas un hasard si Kurt Weill et Bertolt Brecht, en Allemagne, écrivent et composent l'Opéra de quat'sous dans cet esprit-là. Le souvenir de Bruant habitera désormais toutes les tentatives de décrire le monde sale, cruel, et délirant qu’il est.
On comprend alors pourquoi Toulouse-Lautrec, en dessinant aussi bien Bruant que la Goulue, est le témoin précieux de cette transition. Il a vu, mieux que personne, comment la misère se faisait geste, comment le rire devenait coup de reins, comment la peinture pouvait capter l'énergie brute d'un art encore sans nom. Il a saisi cette énergie à l'œuvre dans les cabarets de la Belle Époque, mais dont les retombées se feront sentir bien après. Bruant avait la voix de la révolte ; la Goulue en avait le corps. Ensemble, ils ont préparé la voie à la danse expressionniste, ils ont donné naissance à un langage scénique où la beauté ne tient plus dans une pose mais dans une convulsion.
Ce chemin qui va du Mirliton au Moulin Rouge, de la gouaille à la gambette, du chahut au spasme, dessine une généalogie de la subversion par le corps. Le cabaret est l'atelier d'une modernité radicale, où s'invente dans la poussière, la sueur et la fêlure un art du présent. Et si Mary Wigman a pu déchirer la scène allemande par ses états de transe, c'est aussi parce que, quelques années plus tôt, à Paris, une fille de blanchisseuse levait bien haut la jambe jusqu’à prendre son pied en ricanant. Ce rire-là, grinçant, grotesque et libérateur, est peut-être le vrai berceau de la danse moderne.
1900, la fin en soi
Quand, en 1889, s’élève la tour Eiffel, on veut y voir le totem de la modernité, une apothéose de 10 000 tonnes d’acier riveté d’arrogance technique, 300 mètres dressés face à l’histoire. Mais ce geste brutal de l’ingénierie ne suffit pas à écraser les silhouettes effilées des Apaches de Paris, ni à faire taire les dissonances de la bohème.
En 1891, la cloche du Sacré-Cœur : la Savoyarde, 18 tonnes d’airain, résonne sur les hauteurs de Montmartre. Elle prétend couvrir définitivement les murmures de la Commune, sanctifier la colline où les fédérés ont dressé leurs barricades. En vain. L’ordre s’efforce de graver sa victoire dans la pierre et le métal, mais le souvenir résiste.

L ucien Baylac (1851-1913)
Vue Panoramique de l’Exposition Universelle de 1900
lithographie, 1900 Librairie du Congrès, Washington D.C.
En 1900, on remet ça. L’Exposition universelle, cinquième du nom, prend d’assaut Paris. Une orgie de pavillons, de palais, de fontaines lumineuses, de machines tournantes, d’avenues tracées pour l’occasion, de verrières monumentales et de trottoirs roulants. L’heure est au bilan. Cent ans d’histoire, dit-on, cent ans de progrès, d’inventions, de paix relative et d’expansion coloniale. On ouvre le bal le 14 avril, sous les auspices du président Émile Loubet. On veut croire à la fête, aux chiffres : 51 millions de visiteurs, 212 jours d’ouverture, 112 hectares mobilisés, sans compter les 104 du bois de Vincennes. Le monde entier (ou du moins celui qui compte aux yeux des organisateurs) a été convié.
Un siècle de travestissement
L’Exposition universelle de 1900 est une opération de recouvrement. Elle maquille le tumulte du siècle finissant sous les dorures d’un optimisme de façade. Elle organise, pour ainsi dire, une parade funèbre à grand renfort d’ampoules électriques et de statues colossales. C’est un masque de fer, une gigantesque mise en scène de la victoire de l’industrie, du capitalisme et de la fumée.
C’est-à-dire une réponse, indiscutable musclée au désordre culturel qui, depuis plus de cinquante ans, a trouvé à Paris un foyer incandescent et que l’on soupçonne d’être tout l’objet d’un désir auquel le progrès ne répondrait qu’en termes de besoins.
Ébriété
L’Exposition offre un spectacle grandiose. Sur le Champ-de-Mars, face à la tour Eiffel, le Palais de l’Électricité, conçu par Eugène Hénard, domine comme une cathédrale de la modernité. Il illumine le site, alimente les machines et symbolise la domination humaine sur les forces naturelles. Sa façade illuminée en permanence, surmontée du « Génie de l’électricité », statue de six mètres, relève plus de la théophanie que de l’architecture. La modernité prend ici des airs de divinité.
À ses pieds, les foules s’agitent sur les trottoirs roulants, 3 kilomètres de boucle à deux vitesses suspendue à 7 mètres du sol. On y croise le Cinéorama, le Maréorama, le Panorama Transsibérien, autant de dispositifs voués à simuler le mouvement, à faire croire au voyage tout en vous gardant sur place. À l’intérieur du Palais de l’Optique, la plus grande lunette astronomique jamais construite permet de contempler les étoiles tout en oubliant les morts d’en bas.
Le spectacle est total, jusqu’à l’illusion. On y projette les films des frères Lumière, avec son et image synchronisés — miracle technique. Les bâtiments sont vastes, les avenues neuves, les gares réaménagées (Lyon, Montparnasse, l’Est), et même une nouvelle gare, Orsay, est érigée pour l’occasion. Paris s’équipe : 750 m² de parking à vélos sur les Champs-Élysées, 250 quai d’Orsay. Le métro, fraîchement inauguré, relie Porte de Vincennes à Porte Maillot. Les entrées, dessinées par Hector Guimard, offrent un résumé du style Art nouveau, comme une dernière floraison esthétique avant le gel de l’ère bourgeoise.
Mais cet éclat masque mal les fissures. La passerelle reliant le Globe céleste à l’exposition s’effondre le 29 avril : huit morts, dix blessés. Le 18 août, c’est la passerelle dite « des Invalides » qui s’écroule à son tour après une panique provoquée par un cri : « Ça craque ! ». Quatre morts, une cinquantaine de blessés. Le progrès a le vertige. La foule vacille.
Surtout, l’Exposition est un gouffre financier. Malgré l’affluence, elle est déficitaire. On avait prévu 75 millions de visiteurs, on en aura dix de moins. Le prix d’entrée, trop élevé, dissuade les curieux. Les concessionnaires, pris à la gorge, se mettent en grève. On assiste à des fermetures temporaires, à des remboursements partiels, à des faillites en cascade. L’État ne s’en remet pas : il n’y aura plus d’Exposition universelle à Paris après 1900.
La foire est finie.
Le monde a changé.
Prétexte
Et pourtant, ce qui attire les 50 millions de visiteurs venus du monde entier n’est pas tant ce qu’on leur montre que ce qu’ils espèrent trouver, deviner, capter entre les colonnes et les fontaines : le souvenir, encore vif, du XIXe siècle agité, vibrant, déréglé, frondeur, roublard, sensible aussi. Ce que les foules viennent chercher, ce sont des fantômes : ceux de Lantara, Rimbaud, de Sarah Bernhardt, de Toulouse-Lautrec, de Verlaine, de Louise Michel, de Courbet, de la Goulue, de Ravachol... Ce sont les accents du cancan, les rumeurs du Chat Noir, les soupirs de la Butte, les vapeurs d’absinthe, le désordre sacré de Montmartre, le vent dans la forêt et les odeurs dans l’atelier.
La bohème n’est pas au programme officiel, mais elle est partout dans les esprits. Elle flotte dans l’air comme une mèche rebelle. Elle imprègne les tapisseries, elle hante les murs du Grand Palais, elle ricane dans les interstices. Artistiquement, la postérité de cette époque est immense, presque inconcevable : c’est ici que le monde a appris à voir autrement. C’est ici que s’est formé le regard moderne, et certainement pas du haut de la Tour Eiffel, et certainement pas dans le confessionnal du Sacré Cœur.
La poudre d’Escampette
Et pourtant, l’Exposition cherche à refermer le couvercle. Elle entérine une bascule : ce que le siècle a produit de plus sauvage, de plus fécond, de plus subversif, on tente désormais de l’annexer, de le muséifier, de le neutraliser. Le « bilan d’un siècle » prend la forme d’un enterrement de première classe. À la lumière électrique, le réel se fige. L’avant-garde est recadrée, on la replie dans les manuels scolaires au rayon du « beau ». Pour en détruire la substance on va la faire bouillir d’abord, puis l’enseigner : les gosses vont la détester.
On aura voulu faire de Paris une vitrine du monde. On en fait un mausolée. Mais les morts parlent encore. Et ce n’est pas la lumière du Palais de l’Électricité, ni le vacarme des Jeux olympiques qu’on organise en parallèle, qui étouffera l’écho de ces voix — frondeuses, libres, inclassables. La véritable Exposition de 1900 c’est ce que les visiteurs ramènent chez eux, comme une braise dans la poche : une façon de voir, d’écrire, de vivre ensemble. Une insoumission contagieuse parce qu’elle recoupe d’autres désirs d’insoumission, de vie nouvelle, faite de liberté, d’égalité et de fraternité.
Voyez comme il court, le furet...